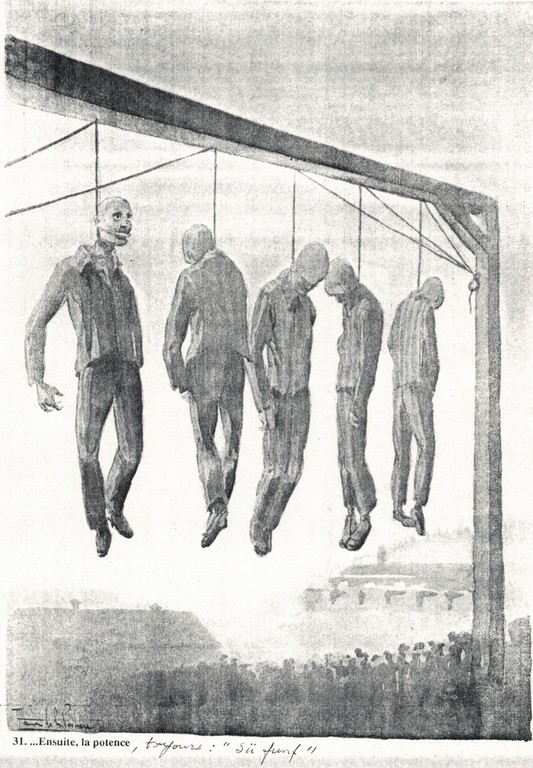- Ma déportation
- La guerre - sabotage des avions français
- Résistance dans l'armée
- Arrestation
- Voyage vers l'Allemagne
- Buchenwald
- Départ de Buchenwald pour Dora-Harzungen
- La vie au camp d'Harzungen
- Mes amis au camp d'Harzungen
- La vie à Harzungen (suite)
- Harzungen : les temps changent
- Nu comme un ver ... et ce n'était pas au paradis terrestre
- Aux tunnels !
- Les pendaisons du dimanche par groupe de 5 "zu Fünf"
- Le sinistre camp d'Ellrich
- Ellrich ! la fin et la faim
- Bergen-Belsen
- Des cadavres et milliers de cadavres
- Retour en France
- Additif écrit en 1996
- Rendons à César
Ma déportation
Albert BANNES - N°: 52 278
______________
(1)
Né en 1914 (2)
Engagé élève pilote en 1935
Sergent pilote au G A O (3) de Rennes de 1936 à 1938
Affecté début 1939 à l'école d'acrobatie d'Etampes
Chasseur à la 3ème escadrille, reçu E O A (4) en mai 1939, sous-lieutenant le 25/12/1939
Campagne mai-juin 1940 au GC 2/9 (5) à Connantre (Marne)
Après la débâcle, GC 2/9 Aulnat jusqu'en Novembre 1942
Participé à la formation de l’OMA (6) , puis ORA (7) camouflage d'armes et d'essence
Région de Clermont-Ferrand à partir de 1941
Résistance à temps complet début 1943, organisation des maquis et des parachutages,
Grossiste en faux-papiers
Arrêté par la Gestapo le 27 mars 1944. Torturé 3 jours
Puis Compiègne, Buchenwald, Bergen-Belsen
Considéré comme mort une dizaine de fois
Revenu vivant d'extrême justesse
Je le suis encore en 1997
______________________________________________________________
(1) Des extraits de ce témoignage ont été publiés aux 3 premiers trimestre 1998 dans la Revue Trimestrielle l’ALPHA de l’AEMA (Association des Anciens Elèves de l’Ecole Militaire de l’Air), N°102, 103 et 104 - La mise en page originale de cette présentation a été conçue par Albert Bannes.
(2) Né le 30 mars 1914 et mort à 89 ans le 7 mai 2003
(3) Groupe Aérien d’Observation
(4) Elève Officier d’Active
(5) Groupe de Chasse-II/9
(6) O.M.A. : Organisation Métropolitaine de l’Armée
(7) O.R.A. : Organisation Résistance de l’Armée
TÉMOIGNAGE - RÉSISTANCE - DÉPORTATION
BUCHENWALD - DORA – ELLRICH - BERGEN-BELSEN
Je suis né dans une ferme isolée, entre Causses et Lévézou en 1914.
Tout gosse, on me traitait de casse-cou, parce que je courais très vite, je sautais des murs très hauts, je grimpais sur les rochers comme dans les arbres, et je n'avais peur de rien. Un jour (je n'avais pas encore 15 ans), le 6 mai 1929 - je m'en souviens parce que c'était le jour de la fête à Millau - mes parents m'avaient interdit d'y aller, mon père avait mis mon vélo sous clef. J'étais allé me promener dans la montagne, et je suis tombé sur une nichée de sangliers. La mère m'avait entendu venir et elle se sauvait suivie d'une dizaine de marcassins. Elle était à plus de 50 mètres, je me suis dit que si j'attrapais le petit dernier, elle ne s'en apercevrait pas, et c'est ce que j'ai fait. Mais il s'est mis à hurler plus fort qu’un cochon qu’on égorge. J’essayais de le faire taire, mais quand j’ai relevé la tête, j’ai vu la mère qui me fonçait dessus, et elle n’était plus qu’à une vingtaine de mètres.
J'ai démarré en trombe, mais je n'ai pas lâché le marcassin que je tenais solidement par une patte arrière. Sur environ 300 mètres j'entendais derrière moi le pas de la mère et même son souffle. Le terrain était en forte pente. Je suis arrivé à une barre de rochers que je connaissais bien et j'ai sauté à l'endroit le moins haut (il devait y avoir 4 mètres). Pendant le saut, le marcassin m’a échappé, mais il s'est assommé en touchant le sol. Je l’ai récupéré et j'ai redémarré. Peu après je n'entendais plus la mère. Je me suis demandé si elle avait cessé la poursuite parce qu'elle n'avait pas voulu sauter le rocher, ou si elle avait arrêté la poursuite parce que le petit ne criait plus. Je suis rentré à la maison. Le petit est revenu à lui un peu avant d'arriver et je l'ai lâché dans la cuisine. J'étais très fier de moi mais mon père m'a passé un sacré savon. Dans les deux villages les plus proches beaucoup avaient entendu hurler le marcassin, et ils demandaient à mes parents pourquoi on avait tué un cochon au mois de mai. Mes parents ont raconté ce qui s'était passé, et je suis devenu un héros communal.
A 17 ans j'ai participé et gagné de nombreuses courses de vélo ; j’ai couru à Montlhéry. A 18 ans j'ai été promu champion de l'Aveyron. Mais en même temps, je pratiquais tous les sports : natation, lutte, boxe, poids et haltères, même du trapèze volant et un peu de rugby. En ce temps-là l'équipe de Millau était célèbre. Mes copains voulaient toujours que je joue « pilier ». Ils ont voulu me faire monter en équipe 1, mais toujours comme pilier... je tenais à mes oreilles et j'ai abandonné le rugby.
En 1935, je me suis engagé comme élève-pilote et j’ai été breveté fin 35.
Fin 38 ou début 39, j’étais volontaire pour un stage de para. J'ai fait ce stage, mais en réalité c'était un stage d'entraînement aux missions très spéciales : j'ai appris à stopper net un chien qui me sautait dessus, à enlever des menottes avec une petite épingle plus vite qu'avec la clé, et surtout, j'ai appris le close-combat, qui est l'art de tuer avant même que l'intéressé ait le temps de s'en apercevoir. Tout cela m'a été très utile.
La guerre - sabotage des avions français
A la déclaration de guerre j'étais pilote de chasse à la 3ème escadrille à Etampes. Le lendemain j'ai été muté au Centre d'Instruction de Chasse (CIC) de Chartres. Les anciens pilotes de la guerre de 14-18, étaient rappelés, il fallait les remettre dans le bain, et si possible les lâcher sur avion de chasse moderne. Nous étions 3 moniteurs pour une trentaine d'élèves. On les essayait sur Morane 230, avion biplace ancien mais très bon pour l'acrobatie, pour les lâcher, s'ils se débrouillaient bien sur avion de chasse moderne : le Morane 406. Même quand tout marchait bien sur 230, la plupart se dégonflaient au moment de partir seuls sur 406. Je n'en ai lâché que 3, dont le célèbre fabricant d'apéritifs Dubonnet, lequel a oublié de payer le traditionnel arrosage qu'on devait payer chaque fois qu'on volait sur un nouvel avion. Mais pendant cette courte période, nous avons aussi essayé des Morane 406 neufs sortant d'usine. Le commandant du C.I.C., nous a convoqués (les 3 moniteurs) et il nous a expliqué : « Nous savons que presque tous les 406 sont sabotés en usine. Les mécanos vérifient tout et ils réparent les sabotages, mais avant de les envoyer en escadrille, il faut les essayer en conditions extrêmes. Vous êtes les plus qualifiés... (pommade habituelle)... Chacun de ces avions montera à 4 000 sans effort, et là vous les secouerez au maximum et dans toutes les positions. Si quelque chose casse vous aurez le temps de sauter en parachute ». Et c'est ce que nous avons fait : un 406 chaque après-midi. Tout s'est bien passé pendant quelques jours, mais un soir je suis monté à 4 000 et j’ai entamé la séance. A la première secousse un peu serrée, mon aileron droit s’est mis à flotter dans le vent tout à gauche, j'ai fait plusieurs tonneaux à droite bien involontaires. Je n'étais pas un novice, j'ai redressé et j'ai vu que j’avais des chances de poser cet avion sans faire trop de dégâts. J'ai averti le sol, ils ont fait sortir les camions incendie et fait dégager la piste. Je me suis posé sans rien casser, mais j'avais eu chaud.
Les mécanos ont dû démonter l'aile droite, pour s'apercevoir qu'un boulon de 6 avait été remplacé par une tige de bois de 6 dans la commande de l'aileron. Ce sabotage était fait à l’intérieur de l'aile pour que les mécanos ne puissent pas le voir, donc au montage en usine. Si la tige avait cassé près du sol, je me serais forcément tué.
Après la guerre j'ai su que 15 pilotes se sont tués sur des 406 sabotés de différentes façons. Tillon était ministre de l'Air, il a fait rechercher tous les rapports faits sur ces « accidents » et il a fait tout détruire.
Paul Martin a écrit un livre « Invisibles vainqueurs : exploits et sacrifices de l'armée de l'air, 1939-1940 (8)» ; il parle des Dewoitine 520 fabriqués à Toulouse. Normalement cet avion aurait dû sortir à la cadence de 24 par mois. En mai 40 près de la moitié des escadrilles de chasse auraient dû être équipées avec cet avion. II était nettement, et était le seul, supérieur au Messerschmitt allemand. Mais en mai 1940 il n'y avait que 2 escadrilles équipées de cet avion. Le chef de la C.G.T. de l'usine Dewoitine disait à qui voulait l'entendre que les D 520 sortiraient quand lui le déciderait. Paul Martin donne des détails et cite des témoins.
Et maintenant les chefs communistes voudraient nous faire croire qu'ils sont des résistants de la première heure !
Depuis septembre 1939, je savais donc à quoi m'en tenir avec les cocos.
Plus tard, en 43 et début 44, j'ai aidé les FTP d'Auvergne, mais à ce moment, ils se battaient avec nous (parce qu'Hitler avait attaqué Staline), pas pour la France. J'ai connu des communistes honnêtes et je suis devenu l'ami de quelques-uns, mais je me méfiais.
J'ai fait la campagne de 40, au Groupe de Chasse 2/9 (9) . Nous avons abattu 27 avions allemands, mais nous avons perdu 12 pilotes (sur 24) et 17 avions Bloch 152.
_______________________
(8) « Invisibles vainqueurs, Exploits et sacrifice de l'Armée de l'Air en 1939-1940 », 1991 , 517 pages, Editions Yves Michelet
(9) Groupe de chasse II/9 (ou GC 2/9)
Résistance dans l'armée
Après la débâcle, nous nous sommes retrouvés à Aulnat (en protection de Vichy), j'étais pilote à la 4ème escadrille, mais en plus j'ai été nommé « Officier de sécurité » du 2/9. A ce titre, j'ai plusieurs fois été convoqué à Vichy pour y recevoir des instructions, qui n'avaient rien à voir avec les instructions officielles. Par exemple, en 1941, quand les permissions pour la zone occupée ont été rétablies, j'ai été chargé, comme tous les officiers de sécurité de Terre et de l'Air (j'ignore pour la marine), de convoquer tous les soldats candidats à une permission en zone Nord, et de les former sommairement à l'espionnage. Je pouvais prolonger leur permission de quelques jours si le site en valait la peine, mais ils devaient absolument rapporter des renseignements sur tous les travaux que faisaient les Allemands. Tous les mois je devais apporter ces renseignements à Vichy, où un officier passait les prendre. Je suis sûr que le maréchal était au courant. Ces renseignements étaient recoupés et regroupés et transmis aux alliés (peut-être pas à De Gaulle). C'était le début de ce qui est devenu l'OMA (10) , puis l'ORA (11) .
II me revient un souvenir curieux : Dès 1941, J'ai eu quelque temps dans mon coffre d'officier de sécurité des spécimens des armes qui nous seraient parachutées plus tard. Je ne me souviens pas qui m'avait remis tout ça. J'en montrais le fonctionnement aux sous-officiers et hommes sûrs. J'avais une sten (12) , du plastic, et des détonateurs de toutes catégories. Un jour j’ai volé une heure avec une bombe aimantée simplement posée contre les ailettes du moteur pour voir si elle tenait malgré la vitesse et les vibrations. Et ça a tenu.
Dès 41, le commandant Rollet (13), commandant du 2/9, m'avait donné l'ordre de remettre toutes les semaines un bidon d'essence de 50 litres à la subdivision militaire, quand on allait chercher les vivres à l'Intendance. Le Colonel Boutet (14) cachait l'essence du côté d'Aubière.
Dès 41, l'armée mettait du matériel de côté, avec l'appui du commandant Fontfrède (15) , commandant la gendarmerie du Puy-de-Dôme.
Après l'arrivée des Allemands en novembre 42, la plupart de mes copains pilotes sont partis à pied, via l'Espagne. Ils ont beaucoup insisté pour que je parte avec eux, mais j'ai refusé. Ils se sont presque tous retrouvés au Normandie-Niemen où ils ont tous été tués sauf Delfino. Le commandant Naudy (16), ancien commandant du 2/9, m'avait demandé de rester, car je connaissais très bien l'Auvergne, je parlais couramment le patois auvergnat, et je connaissais tous les apiculteurs du département. II m'a chargé de rechercher des terrains pour les parachutages, et des endroits propices pour installer des maquis ou cacher des armes.
Au début 43, je ne me suis occupé que de cela. A Clermont-Ferrand il y avait le capitaine De La Blanchardière (17) qui était le chef des transmissions de l'O R A, et beaucoup trop de gens savaient qu'il distribuait à la pelle des cartes d'identité et autres papiers. II a été arrêté au printemps 43. C'est un voisin de Chamalières, le lieutenant Frety (18) qui lui a succédé comme chef des transmissions de l 'O R A, et après un certain cafouillage, j'ai accepté de me charger des faux-papiers, à condition que ce soit un peu plus discret. J'exigeais qu'un seul homme de chaque mouvement connaisse ma boite aux lettres ; j'ai agencé ma chambre de bonne du 22 av de Royat pour cet usage. La Gestapo n'a connu cette boite aux lettres qu'après mon arrestation. Des messages y sont parvenus alors que la Gestapo surveillait l'entrée et ils n'ont vu personne.
Je ne voyais jamais celui qui me portait les imprimés (toujours par pleines valises de chaque catégorie, jamais de mélange). J'ai toujours pensé que c'était l'imprimerie nationale de Vichy qui me les fournissait, mais je ne peux le garantir. Je ne voyais jamais ceux qui apportaient les photos. En principe il ne devait y avoir qu'une seule personne par mouvement de Résistance, et très peu me connaissaient personnellement. Il leur suffisait de connaître l'accès à ma chambre de bonne dont la fenêtre donnait dans la 2ème cour intérieure du 21 av de Royat. Ils déposaient une grande enveloppe sur la table près de la fenêtre, et ils revenaient 8 jours plus tard prendre la même enveloppe ; ils y trouvaient les cartes avec la photo et le timbre fiscal tamponnés de la mairie souhaitée. Normalement ils auraient dû mettre avec les photos, le montant des timbres fiscaux. Mais la plupart du temps, ils oubliaient de mettre l'argent et c'est moi qui payais les timbres sur les crédits ORA. Je ne peux pas dire combien j'ai fourni de cartes d'identité : un peu plus d'une pleine valise que j'avais reçue au départ et que j'ai finie en janvier. J'en ai entamé une 2ème pendant 2 mois. Je recevais aussi des cartes d'alimentation pour les maquis et les clandestins de mon secteur. Un jour j'ai demandé une vingtaine de cartes grises et autant de permis de conduire. Huit jours après j'ai reçu une pleine valise de chaque. Je ne peux pas dire à qui j'ai fourni ces cartes. J'avais reçu l'ordre d'en donner à ceux qui en avaient besoin : prisonniers évadés, réfractaires, juifs, communistes recherchés, etc. Je pense avoir fourni environ 1 000 cartes pour des juifs, mais je n'en ai connu qu'une dizaine auxquels j'ai rempli la carte en totalité. L'un d'eux est encore vivant et j'ai son adresse. J’avais les cachets de toutes les préfectures et de plus de 30 mairies de la région.
___________________________
(10) Organisation métropolitaine de l'Armée
(11) Organisation de Résistance de l’Armée
(12) Pistolet-mitrailleur britannique
(13) Marcel, Eugène, Edmond, Henri Rollet (1889-1988)
(14) Jacques Boutet (1890-1944), fusillé à Clermont-Ferrand le 10 mai 1944. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Boutet_(1890-1944)
(15) Antoine Fontfrède (1899-1945), arrêté le 1er octobre 1944, déporté à Buchenwald, décédé à Dora le 12 avril 1945
(16) André Naudy (1904-1946), mort dans un accident d’avion en Afrique-du-nord en avril 1946. https://www.museedelaresistanceenligne.org/personnedetail.php?id=46171
(17) Michel Lucien Marie Poinçon De La Blanchardière (1915-1944), arrêté en octobre 1943, déporté à Monthausen puis à Melk. Il meurt le 24 août 1944.
(18) Roger Frety (1913-2001), FFI déporté
Arrestation
J'ai été arrêté le 27 mars 44. J'avais reçu un parachutage de 2 avions la nuit précédente, avec le maquis de Prondines. II y avait environ 4 tonnes d'armes et 5 millions en espèces. J'avais laissé à mon adjoint le lieutenant Evans (19) un million pour les maquis du coin et j'étais allé porter le reste à mon chef à Vichy. Il m'avait rendu 600 000 francs dont j'avais besoin.
Chaque fois qu'on recevait un parachutage on devait accuser réception à Londres, en donnant le détail. Et j'ai remis à celui qui faisait la permanence cette liste, en clair ; c'était les radios qui chiffraient. Il avait été arrêté 2 jours plus tôt, et il travaillait pour la Gestapo. J'ai réalisé trop tard, j'ai vu au moins 30 types qui me surveillaient avec une main dans la poche. Ils m'ont laissé parcourir près de 100 mètres, puis, menottes avec mains dans le dos, jusqu'à une traction noire qui attendait au coin de la rue. Dedans il y avait déjà Mme Oppicy (20). Nous étions les 2 premiers de I'O R A arrêtés à cet endroit. Après et les jours suivants, ils ont arrêté 27 officiers et une dizaine de civils.
Quand nous avons franchi les grilles du 2 bis Av de Royat, à 100 mètres de mon domicile officiel, je ne donnais pas cher de ma peau. Dans ma serviette, ils ont trouvé un drapeau tricolore que je faisais hisser dans les maquis où je passais, une lampe torche anglaise très puissante pour les signaux aux avions "parachuteurs", les 600 000 francs qui me restaient et une quinzaine de cartes d'identité avec photo et timbre tamponnés, mais sans aucun nom ni adresse. Naturellement ils ont trouvé que ces photos avaient des têtes de juifs ! Avec tout ça il ne m’était pas facile de leur dire que j'étais là par hasard.
Je savais parfaitement ce qu'ils avaient fait aux généraux chefs successifs de l'ORA, et à bon nombre d'officiers que j’avais connus. J'ai décidé de ne pas ouvrir la bouche même à l'interrogatoire d'identité. J'avais sur moi une carte au nom de Laurel, apiculteur, mais aussi une autre au nom de Laurel recruteur de la L V F (21). Elle était écrite en français et en allemand. Toutes les autorités françaises ou allemandes étaient tenues de me prêter aide et assistance. Je ne répondais RIEN. Ils ont fait venir celui qui assurait la permanence radio, il leur a dit : « Il s'appelle Pougny ». Or Pougny était le commandant Erulin (22), commandant du secteur du Mont-Dore. Il était à l'hôpital avec les 2 jambes pendues au plafond suite à un accident de moto au retour d'un parachutage près de Besse-en-Chandesse alors qu'il roulait feux éteints à moto. Je le remplaçais depuis, et je prenais les messages qui lui étaient destinés, et je signais Pougny ceux que j'envoyais à Londres. Il croyait que c'était mon vrai nom. Ils ont fait venir le commandant Clozel (23) , aviateur. Ils lui ont demandé si j'étais bien Pougny. II leur a répondu : « Non ce n'est pas Pougny que je connais bien, mais je le connais aussi, il s'appelle Bannes, et il était lieutenant pilote au G.C-2/9 ». Clozel avait été arrêté 3 semaines plus tôt et il racontait à la Gestapo tout ce qu'il savait. Je l'aurais étranglé.
J'ai attendu près d'une heure, puis mon interrogatoire a commencé.
Au début des coups de poing, puis la panthère allemande (24) bien connue à Clermont-Ferrand est entrée en action. Elle m'a griffé le visage dans tous les sens. J'étais couvert de sang mais je n'avais pas ouvert la bouche. Ils m'ont fait descendre dans une cellule de 2 mètres sur 1. Le premier soir j'étais seul. Le 2ème jour les lieutenants Fayard (25) et Mollard (26) sont venus me rejoindre, le 3ème jour c'est mon ami le lieutenant Frety (27) avec lequel j'avais fait des tours invraisemblables, et le jour suivant un autre. Nous étions 5 dans une cellule de 2 sur un.
Le 2ème jour j'ai subi 2 interrogatoires. La panthère m'a griffé à nouveau et ça m’a fait plus mal que la première fois. Comme je n'ouvrais toujours pas la bouche, elle est passée derrière moi, il y avait toujours deux types qui me tenaient, et elle a entrepris de m'arracher les ongles. Je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé dans ma cellule. Mais j'ai fait une constatation curieuse, c'est qu’avant de tomber, je la sentais venir et j'éprouvais une sensation de bien-être. De plus j'ai eu l'impression que par effort de volonté j'avais hâté le moment de tomber. Quand je suis repassé à l'interrogatoire, je tombais dès que ça commençait à faire mal. Quand j'étais à terre je me rendais compte qu'ils me filaient des coups de pied, mais je ne sentais aucune douleur. Grâce à cette découverte j'ai supporté 7 ou 8 interrogatoires sans ouvrir la bouche.
Mon ami Frety était un malin. II a échafaudé un plan que j'ai qualifié de farfelu dès qu'il m'en a parlé. Lui me disait : « Si on dit tous la même chose, ils nous croiront ». Après minuit il s'est mis à tapoter sur la porte métallique. Presque tous ses radios avaient été arrêtés, et il y en avait dans toutes les cellules ou presque. Tous répondaient. Quand il est revenu de son interrogatoire, il m'a dit : « Ça prend ! ». J'ai bien appris tous les détails de la mayonnaise qu'il avait montée, et à mon tour, j’ai fait semblant de craquer, et j'ai confirmé ce que Frety leur avait raconté. A ma grande surprise je n'ai plus été interrogé et le lendemain j'ai été transféré à la prison du 92 (28).
Nous étions une bonne trentaine dans chaque chambrée. De l'ORA, il n'y avait que Pierre Jacquin (29) et moi. II était l'agent de liaison de M. Decelle (30), patron de 1 100 résistants du barrage de l'Aigle. Presque tous les autres étaient des communistes. L'un d'eux m'avait rencontré au maquis du Bois des trois-Faux en Corrèze. C'est un maquis ORA au début mais passé ensuite aux mains des communistes. Un autre s'est aperçu que c'était moi qui fournissais les cartes d'identité. Il connaissait ma chambre de bonne. Et finalement ces communistes sont devenus des amis. Ils me croyaient F.T.P. et je me suis bien gardé de les détromper. Plusieurs de ces communistes ont fait avec moi le voyage de Clermont-Ferrand à Compiègne.
_________________________
(19) Michel Guillaume Jacobs (1911-1944), FFI
(20) Fernande Oppicy (1895-1946), épouse Cahez
(21) Légion des Volontaires Français
(22) André Erulin (1907-1951); https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Erulin
(23) Charles Clozel (1892-1944), mort à Dachau
(24) Clermont-Ferrand et l’Université de Strasbourg « la rafle du 23 novembre 1943 » page 20 : 47 https://educdome.puy-de-dome.fr/fileadmin/ressources/fichiers/1624-1674126179-L_Universite_de_Strasbourg.pdf) (cote 908 W 614 aux archives départementales du Puy-de-Dome). Dans un P.V. d’enquête du 29 juin 1946 il est précisé que Ursula Brandt, dite « Lily » serait née vers 1921, qu’elle avait été étudiante à l’Université de Heidelberg. Elle était surnommée « la Panthère » en raison d'un manteau de fourrure qu'elle portait constamment. Elle était l'assistante du chef de la Gestapo de Clermont-Ferrand, Paul Blumenkamp. Elle était secrétaire et traductrice pour le Sipo-SD. Elle a participé activement aux activités de la Gestapo, notamment à la rafle de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand du 23 novembre 1943, où elle faisait le tri parmi les universitaires arrêtés. Elle aurait quitté Clermont-Ferrand pour Heidelberg le 1er mai 1944 (page 178, in : « A nous, Auvergne ! »)
(25) Jacques Fayard (1923-1945), mort en déportation le 6 avril 1945
(26) Roger Mollard (1921-1945), arrêté en mars 1944, déporté à Dora et abattu le 10 avril 1945
(27) Roger Frety (1913-2001)
(28) 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand
(29) Pierre Jacquin (1921-2016), arrêté le 28 mars 1944, déporté à Buchenwald et à Bergen-Belsen; https://www.xaintrie-passions.com/groupement-de-r%C3%A9sistance-du-barrage-de-l-aigle/
(30) André Decelle -1910-2007)
Voyage vers l'Allemagne
Ensemble nous avons mis au point un plan d'évasion immanquable et presque sans danger. Malheureusement un prisonnier monté à Moulins a remarqué les préparatifs et il a prévenu les deux SS qui nous gardaient. Première évasion ratée.
A Compiègne j'ai trouvé le général Verneau (31), chef de I'ORA, et son adjoint le commandant Cogny (32), et une vingtaine d'officiers, un lieutenant des douanes et les gendarmes de Volvic que je connaissais bien. Je logeais avec eux, mais dans la journée, à Compiègne on pouvait se promener dans la cour et je rencontrais souvent les communistes de Clermont-Ferrand. Ils m'ont présenté Marcel Paul, mais je ne savais pas que Marcel Paul était un ponte du P.C. et j'avais complètement oublié son nom quand on m'a parlé de lui à Buchenwald. C'est seulement en 1993, lors de notre pèlerinage, que j'ai compris où j'avais rencontré Marcel Paul pour la première fois.
Nous sommes partis de Compiègne le 12 mai au matin. Nous nous étions groupés autour du commandant Cogny et nous avions établi un plan d'évasion. Nous avions récupéré du matériel, et nous avons réussi malgré une fouille à poil à pénétrer dans le wagon, avec une scie à métaux, des burins et des marteaux, des couteaux, enfin tout ce qu'il fallait pour découper le wagon. Ils nous ont fait monter à 110 dans chaque wagon. Dès que le train a démarré nous avons commencé le travail prévu : découper 2 larges portes de part et d'autre du wagon, mais en laissant un petit peu de bois pour que cela ne se voit pas de l'extérieur Nous avions terminé bien avant la nuit, mais nous avions décidé d'attendre la nuit. Malheureusement dans un autre wagon, ils avaient fait quelque chose de similaire, et ils ont sauté sans attendre la nuit. Les mitrailleuses ont crépité, le train s'est arrêté, et les SS ont inspecté tous les wagons. Ils ont forcément vu ce que nous avions fait. Alors, Ils nous ont fait descendre, partagé en 2 groupes de 55, et à grands coups de crosses dans les reins, ils nous ont fait monter dans d'autres wagons où il y avait déjà 110 hommes. Nous nous sommes retrouvés à 165, et nous y sommes restés 3 jours entiers, sans une goutte d'eau, et pour respirer le peu d'air qui arrivait à passer entre les planches. Les 4 lucarnes étaient recouvertes de planches solidement clouées. Ce que nous avons subi dans ce wagon est indescriptible.
Nous sommes arrivés à Buchenwald le 15 mai au soir. Dans les wagons à 110 il n'y avait que deux ou trois morts, mais dans ceux à 165, on marchait sur les cadavres. Dans le mien il y avait 22 morts, dont un commandant de l'armée de Terre. Pendant 10 jours, je n'arrivais pas à étancher ma soif, et je buvais pourtant d'énormes quantités d'eau.
_________________________
(31) Jean-Edouard Verneau (1890-1944), a participé à la fondation de l’O.R.A. Arrêté le 23 octobre 1943, il est déporté à Buchenwald où il meurt le 15 septembre 1944; https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-%C3%89douard_Verneau
(32) René Cogny (1904-1968), arrêté par la Gestapo en 1943 et déporté à Buchenwald et Monthausen. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cogny
Buchenwald
Je suis resté 15 jours à Buchenwald. II n'y avait plus de place dans le camp principal, et nous avons été logés en dessous, au camp des tentes. Nous étions environ 1 500. Ils nous ont donné trois tentes. Quand elles ont été montées, la moitié à peine pouvaient y tenir. J'ai toujours dormi dehors, comme la plupart de mes copains.
Dans aucun bouquin écrit sur Buchenwald (par des communistes) ils n'ont écrit TOUTE la vérité, car tout près du camp des tentes, il y avait un bordel. Tous les déportés passés par Buchenwald ont pu le voir. Comme les cocos ne veulent pas le dire, je ne manque jamais une occasion de le répéter. Une simple rangée de barbelés nous en séparait. On voyait les filles aux fenêtres, on aurait pu leur parler. A notre arrivée, nous avions cru qu'il était réservé aux SS, mais nous avons appris qu’il était là pour les gradés du camp.
Je dois expliquer comment fonctionnait cet immense camp. Tous étaient sur le même modèle. Il y avait un chef de camp SS et ses officiers et la troupe. Ils étaient à l’extérieur du camp, ils occupaient les miradors, encadraient les corvées extérieures, etc. Les SS ne pénétraient dans le camp que pour les appels, les pendaisons ou autres cérémonies. Toute l'organisation intérieure du camp était dirigée par des déportés. A Buchenwald les communistes avaient pris le pouvoir et ne risquaient pas de le lâcher. Dans d'autres camps c'était les « droit commun », ailleurs les tziganes, etc.
II y avait un Lagerältester (33), des chefs de block, avec toute l'armada des Kapo (34), des stubendienst (35) , vorarbeiter (36), etc. Ils portaient tous un brassard indiquant leur grade. Je n'ai vu qu'une fois le Lagerältester. Il était assis sur un redan du rocher, tout en haut de la carrière. On était obligés de passer tout près de lui quand on remontait, avec notre bloc de pierre sur le dos. Certains ont dit qu'il était là pour vérifier que la pierre était assez grosse. J'ai eu l'impression qu'il s'en foutait pas mal, et qu'il était perdu dans son rêve intérieur. Mais ce qu'on était obligé de voir : il faisait déjà chaud, et il était venu torse nu prendre le soleil. Sans exagération, son ventre dépassait ses genoux. Il était à Buchenwald depuis 1934 (10 ans) nous a-t-on dit. Tous les gradés avaient droit de vie et de mort sur nous.
A Buchenwald, Marcel Paul n'était pas kapo, il était bien au-dessus, il était chef de l’Arbeitsstatistik (37) . Il était sous l'autorité des SS. Théoriquement ce service devait sélectionner les détenus, selon leur métier et leurs capacités, pour les envoyer dans les différents Kommandos. En réalité, ils planquaient les communistes importants, mais systématiquement ils envoyaient tous les officiers à Dora, où la moyenne de vie était de 45 jours. Ce système n'a pas été mis en place par Marcel Paul, il fonctionnait bien avant. D'ailleurs, il est arrivé un jour après moi, mais dès son arrivée, il a été placé là. Je ne leur en veux pas tellement pour ça. Si nous, les militaires, avions été à leur place, nous aurions sans doute fait un peu la même chose, mais nous aurions quand même respecté le règlement militaire qui prévoit que dans un cas de ce genre on doit sauver les « élites ». Mais Marcel Paul a été bien plus salaud comme je vais l'expliquer plus loin.
A Buchenwald, I'ORA avait quand même un petit service de renseignements. Quand je suis arrivé, on m'a dit : « Surtout ne dis jamais que tu es officier. Quand tu passeras à l'arbeitsstatistik, dis-leur que tu es électricien, ou mieux radio-électricien. Les SS en ont besoin pour fabriquer du matériel pour les avions, les chars et les fusées ». J'étais réellement qualifié pour ce travail, et c'est ce que j'ai dit ; puis j'ai attendu.
Quelques jours après, deux types avec brassard sont venus au camp des tentes, et ils ont appelé Albert Bannes. Je n’ai pas répondu, et mes copains se sont bien gardés de parler mais ils sont revenus le lendemain et ils ont appelé mon numéro. Je ne pouvais pas y échapper et je me suis présenté. Ils m'ont dit : « Mais on ne te veut pas de mal. Marcel Paul te connait, il sait que tu as fourni des cartes d'identité aux communistes d'Auvergne et même que tu as fourni des armes au maquis des Trois-Faux en Corrèze». Je ne me rappelais pas que j'avais parlé avec Marcel Paul à Compiègne, et je leur ai demandé qui était Marcel Paul. Ils m'ont répondu qu'il était maintenant le chef de l'Arbeitsstatistik et que si je voulais marcher avec eux il me trouverait une bonne planque à Buchenwald. Je réfléchissais, ils m'ont dit : « On reviendra demain ». J'avoue que j'ai hésité, j'en ai parlé au général Verneau et au commandant Cogny mais aucun ne m'a donné de conseil. Quand ils sont revenus je leur ai dit de remercier Marcel Paul de ma part, mais que je préférais suivre mon sort.
La fin de la quarantaine arrivait, et un matin on m'a appelé. Je me suis retrouvé sur la place d'appel, près de la sortie, avec environ 150 hommes, parmi lesquels je ne connaissais personne. Un SS nous a annoncé que nous partions pour Shönebeck. C'était l’usine qu'on appellerait maintenant d'électronique. J'aurais sauté de joie. Mais alors que nous allions monter dans les camions, voilà 3 types à brassard qui se pointent, et se mettent à appeler le 52 278, en allemand. Je n'avais pas encore appris mon numéro en allemand.
Ils ont eu beau hurler je ne répondais pas, et pour cause. Alors ils sont passés dans les rangs et le premier qui m'a vu m'a pris au col et sorti des rangs. Tous les 3 avaient leur « goumi » et ils m'ont tapé dessus un bon moment. Puis ils m'ont ramené au camp des tentes, et le seul qui parlait français m'a dit : « Faut être con pour refuser quand Marcel Paul te propose une planque. T'as pas fini de le regretter ! ».
Le lendemain je me suis retrouvé sur la place d'appel avec 1 500 autres, et nous sommes partis... pour Dora (la mangeuse d'hommes).
Si j'avais été affecté directement à Dora, je ne me rappellerais même pas de Marcel Paul, mais il m'a fait sortir d'un Kommando peinard pour m'envoyer crever dans le plus épouvantable… ET tout ça, parce que j'avais aidé les communistes en Auvergne. Comment pourrais-je lui pardonner ?
C'est pourquoi j'ai sciemment provoqué la bagarre en janvier 46 à Clermont-Ferrand.
En rentrant j'avais adhéré à la FNDIRP (38) (il n'y en avait pas d'autre) section de Chamalières où j'habitais à nouveau. La section de Clermont était rouge vif, et celle de Chamalières, le contraire. Madame Michelin faisait partie de notre section et le l'ai vue plusieurs fois aux réunions. Pour essayer de nous entendre, nous avons décidé de faire une réunion de toutes les sections. Nous avions exigé que toutes les décisions importantes seraient votées à bulletin secret. Chaque section devait envoyer un certain nombre de délégués qui seraient les seuls à voter. J'avais été désigné comme président de la commission des mandats. Le matin de la réunion j'avais fait mon travail sérieusement. J'avais fait la liste des mandatés et prévu pour émarger, etc.
La réunion allait commencer, la salle était pleine, environ 600 personnes dont beaucoup de veuves. Voilà Marcel Paul qui se pointe. Il était ministre, il a fallu lui faire une place à la tribune. Je commençais à bouillir. Les communistes l'avaient invité sans en parler aux autres sections. Discours de bienvenue, blabla habituel, puis la réunion commence. Au bout d'un moment, je ne me rappelle plus à quel sujet, quelqu'un a dit : « Il faut voter !' ». Marcel Paul s'était installé au centre, j'étais à l'extrémité droite de la tribune. Sans la demander, j'ai pris la parole (je n'ai pas besoin de micro) et j'ai annoncé : « Vous savez tous que chaque section a désigné des délégués pour les votes, je vais donc les appeler à tour de rôle pour voter ». Marcel Paul a levé les bras au ciel en disant : « Mais on n'a pas de temps à perdre, on vote à mains levées ! ». J'ai aussitôt répliqué que les sections étaient toutes d'accord pour voter à bulletins secrets. Le ton est très vite monté entre Marcel et moi, je ne faisais rien pour arrondir les angles, bien entendu. Les communistes prenaient parti pour Marcel Paul, et très peu me soutenaient. Alors je me suis adressé aux veuves : « Vous Mesdames, dont les maris sont morts à Dora, savez-vous qui les a désignés pour aller à Dora ? c'est lui ! ». Il s'est levé, l'écume aux lèvres, j'étais debout, et il s'est jeté sur moi en essayant de m'envoyer un coup de poing. II avait beau être plus gros que moi, il ne m'impressionnait guère. Je n'ai eu aucun mal à dévier son poing pendant que je lui envoyais mon droit sur le nez, et il a dû le sentir un bon moment. Naturellement tous les gens présents à la tribune se sont interposés. Alors j'ai annoncé : « Nous ne sommes pas venus ici pour nous mettre aux ordres des cocos. Je quitte la salle, ceux qui pensent comme moi peuvent me suivre ». La moitié de la salle s'est vidée.
Dehors, quand j'ai retrouvé ma femme, elle pleurait presque, elle m'a dit : « On n'a pas idée, frapper un ministre devant tant de monde, il va porter plainte et nous n'avons pas fini d'avoir des em… ». Je lui ai répondu : « T'en fais pas pour ça, il ne risque pas de porter plainte, il sera bien content de s'en tirer comme ça, il ne souhaite pas voir déballer ce qu'il faisait à Buchenwald ».
Je reviens à Buchenwald. Vous avez peut-être entendu dire que Marcel Paul avait « fait crever » le père Michelin, et sauvé Marcel Bloch (Dassault). Voici ce que je peux en dire.
Tous les bouquins sur Buchenwald en parlent comme terrible, qu'est-ce qu’ils auraient dit s'ils avaient creusé comme moi des tunnels à Dora pendant 10 mois. Moi j’étais heureux quand j'allais travailler à la carrière. Cela me faisait un peu d'exercice. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre de Monsieur Decelle, ancien chef des résistants du barrage de l'Aigle, devenu grand patron d'E D F. maintenant en retraite. Il me signalait que mon ami Pierre Jacquin avait écrit qu'à Buchenwald, je trouvais la vie trop facile, que je retirais mes claquettes et que je marchais pieds nus sur les cailloux fraîchement coupés. Il me demandait si c'était vrai et pourquoi. Je l'avais complètement oublié mais je m'en souviens. J'ai répondu à M. Decelle en lui disant que c'était bien vrai, et que ce n'était pas pour faire pénitence, mais pour m'endurcir la plante des pieds, en prévision d'une évasion que j'espérais encore possible.
Donc, nous revenions de la carrière, nous descendions la principale avenue de Buchenwald, nous avons vu un groupe de russes (peut-être un millier) qui se formaient en colonne un peu plus bas, et ils défilaient lentement devant l'entrée d’un block, en tendant le poing, et en insultant quelqu'un. Quand je suis arrivé à hauteur de ce block, j'ai vu un pauvre diable très mal en point assis sur une marche, avec 2 types à brassard, qui manifestement l'obligeaient à rester là. Notre colonne se dispersait un peu plus bas, à l'entrée du camp des tentes, près du block des lavabos, toilettes, etc. J'y suis entré pour boire, car j'avais encore toujours soif. J'ai aperçu deux anciens avec le F, et je leur ai raconté ce que je venais de voir. Ils m'ont de suite répondu en riant : « C'est le père Michelin ! ». Chaque fois qu'il y a un arrivage de russes, on leur propose de « voir un capitaliste », et ils défilent pour voir Michelin. Ça amusait aussi mes 2 français. J'avais envie de leur dire qu’ils étaient encore plus cons que les russes, mais je n'ai rien dit. C'était sans doute deux communistes de bas étage, planqués comme balayeurs. Cela m'est resté en travers de la gorge, et j'ai souvent pensé au père Michelin.
Je dois dire que Marcel Paul venait d'arriver et qu'il n'était pas l'organisateur de ces cérémonies. C'est quelques jours après qu'il m'a proposé de me planquer à Buchenwald et le souvenir de ce que j'avais vu avec Michelin m'a influencé pour décliner cette offre. Jamais je n'aurais pu « marcher avec eux ».
Quant à Marcel Bloch (Dassault) je n'avais jamais entendu parler de lui à Buchenwald. C'est seulement après la guerre que j'ai appris qu'il était resté à Buchenwald. Et c'est seulement en 56 ou 57, que j'ai pu lui parler. Je commandais alors la station radar du Mont Agel, près de Nice. Le hasard a voulu que je passe une heure en tête-à-tête avec M. Dassault.
Je lui ai dit que j'avais piloté un Bloch 152 pendant la campagne de 40, et jusqu'à la fin 42. Je lui ai raconté que si j'étais encore en vie c'était grâce au blindage qu'il avait mis derrière le siège du pilote. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé sur cet avion, très solide et que je le trouvais très maniable, même si ce n'était pas l'avis de tous. Je lui ai raconté comment à la suite d'un pari avec le capitaine Delfino (39) , j'avais fait un looping à l'envers avec cet avion. Lui-même ne croyait pas la chose possible. II était loquace tant que j'ai parlé de son avion de chasse, mais dès que j'ai dit que moi aussi j’avais connu Buchenwald il est devenu muet, disant simplement qu'il ne voulait pas se rappeler les mauvais souvenirs.
C'est tout ce que je peux vous dire sur Marcel Paul. Vous savez sans doute qu'il a beaucoup grossi pendant qu'il était à Buchenwald... s'il y était resté 10 ans, comme le lagerältester, son ventre aurait peut-être atteint la ligne des genoux. II a eu de la chance de ne pas être libéré à Bergen-Belsen… parce que ceux qui étaient gros et gras, et surtout s’ils portaient la marque d'un brassard, étaient trucidés sans jugement, comme je le raconte à la fin.
J’ai écrit que chaque équipe de 3 X 8 était de 1 500 détenus, c’est par erreur ; elle était au maximum de 1 050.
En Juin-Juillet 44, nous étions 350 pendant qu’on creusait le début des 28 tunnels. Quand on a atteint la première ligne de salles qui reliaient les tunnels entre eux, une équipe a continué tout droit et une autre a creusé la 1ère salle. L’équipe est donc passée à 700. A Harzungen dans notre block nous avons dû coucher à 2 par lit et par étage, soit 6 par lit.
Début septembre, le tunnel arrivant au niveau des 2ème salles, l’équipe a de nouveau augmenté de 50% mais pas doublé comme je l’ai écrit plus haut. Nous avons dû dormir à 3 par étage (9 par lit). On avait toujours les pieds d’un copain dans le nez, car on devait se mettre tête-bêche. Comme nous étions fatigués à l’extrême, on dormait quand même.
Nous n’avons pas dû dépasser le chiffre de 1 000, car il y avait des morts et des malades qui entraient quand même au revier. Quand nous avons rejoint Ellerich (en février je crois) nous devions être environ 900 à chaque équipe. A l’embarquement pour Bergen-Belsen, notre équipe tenait dans un seul wagon (environ 90). A l’arrivée à Bergen, nous n’étions plus qu’une trentaine, et j’étais le seul français survivant. A Bergen-Belsen il y a encore eu beaucoup de morts. Nous n’avons rigoureusement rien eu à manger entre le 5 et le 15 avril 1945… et si peu depuis le 25 mars !
__________________________
(33) Détenu doyen du camp responsable de sa gestion
(34) Détenu responsable d’un kommando de travail
(35) Responsable de l’ordre dans la chambrée d’un block
(36) Contremaître
(37) Bureau des statistiques du travail
(38) Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes
(39) Louis Delfino (1912-1968), intègre l’escadron de chasse Normandie-Niemen le 28 février 1944. https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Delfino
Départ de Buchenwald pour Dora-Harzungen
Le lendemain, donc, au lieu de partir au kommando des électriciens, je me suis retrouvé sur la place d'appel, mais pour partir pour Dora ! Pire, j'ai perdu de vue tous mes copains de l'ORA. J'ai vainement cherché le commandant Cogny et les autres. J'ai su beaucoup plus tard qu’eux aussi avaient été expédiés à Dora par les bons soins de Marcel Paul, mais je ne les ai pas vus dans ce convoi. Nous étions environ un millier. Il y avait les 500 de Saint-Claude, ou du moins une bonne partie, et beaucoup de belges. Peu de russes dans ce « transport ». Dans ces cas-là, on cherche toujours à se regrouper. J'ai retrouvé Bigot (40) de Vichy et Vincent Buiguez (41), et nous sommes restés ensemble.
Nous sommes bien arrivés à Dora. On nous a fait marcher vers une colline et on nous a parqués sur un petit espace, près d'un minuscule ruisseau. II pleuvait, le terrain était extrêmement boueux, et nous sommes restés là environ 2 jours, sans bouger. Pour dormir il fallait s'allonger dans la boue, mais on se disait que les poilus de 14-18 avaient bien fait ça avant nous. Ce qui nous a le plus fait chuter le moral, c'est que nous avons vu passer devant nous, plusieurs fois, des colonnes de malheureux, complètement décharnés, qui marchaient comme des automates, sans nous adresser un seul regard ! Pourtant il y avait des Français. et j'ai essayé de leur parler, mais aucun ne m'a répondu… J'ai compris : aucun n'avait la force de me répondre. Nous avons compris ce qui nous attendait. L'épouvante nous gagnait de plus en plus.
Je ne sais pas exactement combien de temps nous sommes restés là. On nous a distribué une soupe ou deux. Nous pouvions boire l'eau qui coulait. En regardant vers le bas, nous pouvions apercevoir des baraques, mais nous n'avons vu aucune entrée de tunnel. Nous avons su plus tard, que le creusement coté Dora était terminé, et on nous a fait redescendre, puis monter dans des camions et nous sommes sortis de Dora. On pleurait de joie ; je n'étais quand même que partiellement rassuré.
Nous sommes arrivés ½ heure plus tard à l'entrée d'un petit camp où il n'y avait encore que 4 ou 5 blocks. Un petit ruisseau le parcourait. A côté du sinistre Dora ce camp nous a paru un paradis ! C'était Harzungen.
Les 2 ou 3 premiers jours, nous avons monté plusieurs baraques, avec bonne volonté, et comme nous avions pris de l'avance avec une vingtaine de copains, nous avons élargi le petit ruisseau et approfondi sur 1 mètre ou 1 m 50, et nous nous sommes baignés. On commençait à croire que la vie de château allait durer. Nous dormions dans un des blocks que nous avions montés, il n'y avait ni lit, ni paillasse, mais c'était mieux qu’à Buchenwald ou Dora.
Le 4ème jour, on nous a mis en colonne par 5 et fait sortir du camp, puis monter dans des remorques (de type agricole). Un tracteur 2 cylindres a tiré le total. Nous avons traversé Woffleben, et nous sommes arrivés dans une vallée assez large, où il y avait déjà eu des travaux par-ci par-là mais rien de précis à nos yeux. Le kapo a formé 28 groupes d'une douzaine de détenus, et il nous a mis à la disposition d'un meister (42) . Ce meister nous a dit de le suivre, il nous a amenés assez loin et arrivés à un certain endroit, il nous a dit : « Voilà le stollen 27 ! » (tunnel). Vous vous en souviendrez. A partir de maintenant vous travaillerez toujours ici ! ».
Les premiers jours, avec des pics et des pioches nous avons dégagé le terrain en jetant les déblais dans la pente. On travaillait seulement de jour mais ça n'a pas duré longtemps. D'autres détenus qui venaient d’Ellrich installaient dans le lit du ruisseau de grosses buses rondes.
Des renforts, surtout des russes et des polonais, sont arrivés à Harzungen. Dans notre block l'effectif qui était de 300 environ est passé à 750, et plus tard à 900. Tous les détenus du block formaient une équipe. Au tunnel 27, comme pour les autres, notre nombre a augmenté dans les mêmes proportions. Ils avaient amené un énorme compresseur, des perforatrices, une petite voie Decauville et un wagonnet ! Ils avaient décidé de faire les 3 X 8. II y avait trois blocks comme le mien, et chacun constituait une équipe. Pendant une courte période, le transport avec le tracteur agricole ne suffisant plus, nous avons bénéficié d'un train qui nous amenait presque sur place, du moins pour ceux qui travaillaient dans les premiers tunnels. Le tunnel 27 où je travaillais, et encore plus pour le 28, exigeait peu de marche. Je crois bien que cela n'a duré que 15 jours ou 3 semaines. Ensuite il a fallu faire tout le chemin à pied, jusqu'à la fin.
Le tunnel prenait forme. Je m'étais fait affecter au wagonnet que je poussais avec mon ami Vincent. On vidait les cailloux en direction des buses, et petit à petit on comblait la vallée. Nous étions gardés par 2 sentinelles. II y en avait 2 par tunnel. C'était des anciens de la Luftwaffe et ils n'étaient pas méchants du tout.
____________________
(40) Albert Bigot (1900-1988)
(41) Vincent Buiguez (1921-1997), arrêté le 21 mars 1944, déporté à Buchenwald puis Dora et Harzungen. https://asso-buchenwald-dora.com/buiguez-vincent-klb-52186/ - https://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1038679
(42) Contremaître dans une usine
La vie au camp d'Harzungen
Les tout premiers jours, nous pensions avoir trouvé un petit paradis dans l’univers concentrationnaire. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que les coups arrivaient à l’improviste et que ça pouvait faire très mal.
Tout le commandement du camp était assuré par les tziganes, allemands pour la plupart. Ces voleurs de poules méprisés partout tenaient enfin leur revanche.
Il y avait partout des chutes de câble électrique à 4 fils. Il y en avait de petits, mais il y en avait qui faisaient de 25 à 30 millimètres de diamètre. Tous ces garde-chiourmes avaient coupé des longueurs de 1 mètre environ. Ils décortiquaient la gaine principale, coupaient 2 fils, et arrangeaient les 2 autres pour les nouer de façon à les glisser autour du poignet, et ils déambulaient fièrement dans le camp, avec leur arme inséparable. Ils appelaient ça un « goumi » ! C'était plus souple qu'un nerf de bœuf, mais je peux assurer que cela faisait terriblement mal !
J'ai fait la connaissance de cet outil le 3ème jour. Le stubendienst, un petit tzigane, gras comme un moine, est entré dans le block en gueulant pour nous faire lever. Comme on couchait à même le plancher, j'étais en train de me lever, j'en ai pris un coup réellement en travers de la figure, sur la joue droite, entre les deux yeux, le haut du front et une partie du cuir chevelu. Je suis retombé, mais je me suis vite relevé car il aurait recommencé. Je suis allé au tunnel, cela me faisait très très mal toute la journée et même plusieurs jours. Ce stubendienst m'avait pris « en amitié », il avait appris que j'étais officier et il éprouvait une indicible jouissance quand il pouvait me taper dessus. Pendant tout le temps que je suis resté à Harzungen, il se tenait à la sortie du block et chaque fois qu'on entrait ou qu'on sortait, il me cherchait, pour essayer de m'en filer un bon coup, mais moi aussi, je surveillais et j'esquivais souvent, malheureusement pas toujours. Quelques fois c'était lui qui distribuait la soupe, alors quand je présentais ma boite, il vidait à côté, et j'avais bien du mal à récupérer quelques gouttes. II faut préciser qu'à Buchenwald on nous avait donné des gamelles assez larges. Chacun avait la sienne. Mais pendant notre court séjour à Dora, on nous a volé à peu près toutes ces gamelles. En arrivant à Harzungen, on nous a dit que près des cuisines il y avait une décharge, où on trouvait des boites de conserve, et nous avons presque tous récupéré des boites de la dimension des boites de petits pois (un litre) ; on les pendait au pantalon et on ne s’en séparait plus. Le malheur est que ces boites étaient un peu plus petites que la louche et on perdait toujours un peu de soupe même quand c'était le chef de block qui distribuait la soupe, ce qui heureusement pour moi, était le cas général.
Ce stubendientz, ne tapait pas que sur moi, mais tous mes copains avaient bien remarqué qu'en passant un peu devant ou un peu derrière moi, ils ne risquaient à peu près rien. Il arrivait fréquemment qu'un détenu soit condamné à recevoir « les vingt-cinq coups ». Il y avait une espèce de chaise spéciale pour cette opération. Le stubendienst était toujours volontaire pour les administrer, et il fallait voir avec quel plaisir il effectuait son travail. Cela ne m’est arrivé qu'une seule fois ; je ne me souviens plus du motif. Ils trouvaient toujours de bonnes raisons. Il n'a pas pu taper plus fort sur moi que sur les autres, car il y allait toujours de toutes ses forces.
Pendant les premiers mois, j'étais très costaud, et j'ai tenu le coup mais tous les français qui sont passés sous le goumi de ce sale tzigane, n'ont pas pu faire comme moi et ils ne s'en sont pas tous remis.
L'infirmerie n'était quand même pas sous le commandement des tziganes. C’était deux français, les frères Dezpres (43) qui étaient médecins. Après la Libération certains français les ont beaucoup critiqués. Personnellement, je crois qu’ils ont fait tout ce qu’ils ont pu. Ils ne pouvaient tout de même pas admettre tous les Français au revier. J'ai été blessé le 13 août, je crois. J'espérais me faire admettre et ils ne m'ont pas pris. Ils n'avaient rien pour désinfecter ma blessure, et ils m'ont dit de revenir 8 jours plus tard parce qu'ils espéraient recevoir du ? (44) qui empêcherait ma plaie de s'infecter. En attendant j'ai fait comme les autres : on prenait de la roche pulvérisée par les foreuses, on en recouvrait la plaie, et on entourait avec du papier de sac de ciment, le tout maintenu avec du fil de cuivre très fin (celui qui servait à relier les détonateurs). Je suis passé au revier 8 jours plus tard, l’un des Dezprez m'a enfoncé une espèce de crayon dans la plaie et il a tourné 2 ou 3 fois. Cela m'a fait très mal pendant une heure, mais ma plaie ne s'est jamais infectée (45). A noter qu'elle n'a pas guéri non plus… J'ai trainé ça jusqu'à mon retour en France, c'est-à-dire pendant 8 mois. Début janvier 45, mon copain Bigot n'en pouvant plus est tombé d'épuisement au travail. Je l’ai porté sur mon dos - il ne pesait pas bien lourd - jusqu’au camp et jusqu’au revier. Les frères Desprez l'ont admis et ils l’ont tiré d’affaire.
_________________________________
(43) Jacques Desprez (1909-1979) dentiste et Georges Desprez (1903-1980) médecin. Georges a travaillé pour l’organisation Todt mais soupçonné d’escroquerie il est envoyé à Buchenwald, Dora et Harzungen. https://asso-buchenwald-dora.com/de-sesmaisons-jean-klb-49415/
(44) Sulfamide ou pénicilline ?
(45) Probablement une seringue de pénicilline
Mes amis au camp d'Harzungen
Une dizaine de jours après notre arrivée, en revenant des tunnels, on a demandé s'il y avait des «friseurs» parmi nous. Mon ami Vincent hésitait à lever la main. C'était toujours risqué. On pouvait l'obliger à couper les cheveux après le travail au tunnel ! Je lui ai dit que, à sa place, je tenterais ma chance. Il l'a fait et il n'est plus venu au tunnel.
Comme il était excellent coiffeur, les chefs de block, kapo, etc., qui eux avaient les cheveux longs, étaient très heureux de se faire coiffer par Vincent, et certains lui en étaient reconnaissants. Vincent n'a jamais oublié ses copains. Presque tous les jours il allait chez des chefs de block pour se faire donner une gamelle de soupe. II faisait semblant d'en manger un peu, mais il nous 1'apportait, et nous la partagions Bigot et moi. Vincent ne l'a pas fait que pour nous deux. II a rendu service à beaucoup de français. Je lui dois beaucoup.
Nous n 'avions guère le temps de « fréquenter » des copains en dehors de notre block, pour la bonne raison qu'on se voyait rarement. J'étais devenu ami avec deux officiers, De Sesmaisons (47) et Vincent-Carrefour (48) . A la petite équipe des électriciens de Harzungen (ils n'étaient que dix français) commandés par Schock (49) qui était à Londres à l'Etat-Major de De Gaulle et qui avait été parachuté plusieurs fois en France, et pris à sa dernière mission. Il y avait là Schock (Chevalier) et deux autres dont je ne me rappelle pas les noms. Ils m'ont donné un peu à manger en décembre (explications plus loin) mais en temps normal je ne pouvais pratiquement jamais rencontrer quiconque en dehors de mon équipe.
Dans mon équipe j'étais très copain en dehors de Bigot, avec Coquelle (50) , un grand costaud, et surtout avec Gras (51) . Avant son arrestation il était percepteur de Grenoble. Confidentiellement il m'avait dit qu'il était 33ème en franc-maçonnerie, l'égal de Chautemps (52) m'a-t-il dit. C'était vraiment un homme exceptionnel. II avait passé l'hiver 43-44 à Dora, et il disait : « Quand on a tenu le coup à Dora pendant l'hiver 43-44, c'est qu'on est increvable. Je suis sûr de rentrer en France, etc. etc. ». Gras remontait le moral de tous, et il était costaud, lui aussi.
II y avait bien d'autres copains, y compris des belges, mais nous étions moins proches et j'ai oublié leurs noms.
Dans notre block, il y avait même un curé polonais. II nous avait demandé de rester avec nous, parce que du côté des russes et polonais, la vie était intenable.
Je ne voudrais pas oublier de citer un malheureux parmi les plus malheureux. C'était Charmaison (53); il était le maire de Romorantin, et comme ma femme était réfugiée à Romorantin, nous avions sympathisé plus spécialement. Il portait des lunettes, et comme tous ceux qui étaient dans ce cas, la situation devenait vite dramatique avec tous les coups qu'on recevait, les lunettes ne duraient guère, et la plupart ils les jetaient, et se débrouillaient sans, mais Charmaison, sans lunettes, n'y voyait plus rien, il les réparait. II a commencé pendant l'été, en réparant un côté. Aux tunnels il y avait toujours du fil de cuivre très fin, (pour relier les détonateurs entre eux) et avec ce fil il avait fait une sorte de grillage de part et d’autre du verre pour le maintenir. Puis il a fait la même opération à l'autre verre. Puis il devait recommencer et faire des mailles plus fines. Fin 44 il avait perdu la totalité d'un verre et de l'autre côté les fils de cuivre étaient tellement serrés que je me demandais comment il pouvait encore voir quelque chose. Je le plaignais beaucoup. Heureusement il est rentré au revier, grâce à Desprez et il a évité le départ à Ellrich, et il est rentré en France.
Les russes et les polonais occupaient l’autre côté du block, mais au travail nous étions mélangés. Non seulement ils nous volaient nourriture, claquettes, bérets et tout ce qu’ils pouvaient, mais il y avait un groupe de russes bagarreurs qui sont vite devenus insupportables. Quand on partait au travail, dans une colonne de 750 les premiers rangs marchent régulièrement, mais la colonne fait toujours l’accordéon, les derniers, et bien avant, sont toujours en train de piétiner puis de courir sous les coups de crosse. Alors on avait tout intérêt à se trouver autant que possible, en tête de colonne. Dès le signal on se levait très vite pour se mettre en rang et en tête. Les russes ne se pressaient pas, mais ils arrivaient en force, nous bousculaient tous et se mettaient à notre place. Il ne nous restait qu’à aller prendre la queue de la colonne. Avec Gras, Coquelle et quelques autres nous avons décidé de réagir. Nous nous sommes mis sur le côté gauche, au point où les russes avaient pris 1'habitude d'éjecter les Français. Nous avions pris ce que nous avions pu trouver pour nous défendre, et lorsque les russes ont tenté leur manœuvre, ils sont tombés de haut. La plupart se sont retrouvés à terre. Je ne sais s'ils ont été admis au revier, mais ils ne nous ont plus pris pour des couards.
_______________________________
(47) Jean De Sesmaisons (1924-1948), arrêté le 8 février 1944, déporté à Buchenwald et à Harzungen, mort pendant la guerre d’Indochine. https://asso-buchenwald-dora.com/de-sesmaisons-jean-klb-49415/
(48) Jean Vincent-Carrefour (1911-2000), résistant, arrêté en octobre 1943, déporté à Buchenwald puis à Dora; http://avc0635.free.fr/jeanvc/
(49) André Schock (1914-1973), alias Chevalier, FFC, arrêté le 28 janvier 1944, déporté à Buchenwald puis à Harzungen et Bergen-Belsen. https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Schock
(50) Charles Coquelle (1920-1945), déporté en 1944, mort à Ellrich
(51) Fernand Gras (1893-1945), FFI déporté à Buchenwald et à Ellrich, mort le 17 mars 1945
(52) Camille Chautemps (1885-1963) ancien ministre, franc-maçon
(53) Jean-Paul Charmaison (1911-1976)
La vie à Harzungen (suite)
Avec les russes et les polonais, il fallait toujours être sur ses gardes. Ils nous détestaient, et nous le leur rendions bien. Je m'étais quand même fait 2 amis parmi eux : Le premier était de ma petite équipe du tunnel 27. Au début il surveillait le compresseur à l'entrée du tunnel lorsque j'étais préposé au wagonnet.
Lui aussi s'était trouvé une petite planque… On respirait mieux dehors que dedans. Pour lui comme pour moi cela n'a pas duré longtemps, hélas. Nous arrivions à nous comprendre et il m'avait expliqué qu'en Russie il était écrivain public. II y avait très peu de russes qui savaient lire, et encore moins qui savaient écrire. Lui, gagnait sa vie en écrivant pour les autres. Il m'a dit que les russes qui étaient avec nous ne savaient pas écrire non plus, sauf un qui était lieutenant dans l’armée de Joukov. Il m'a dit que les russes évolués, membres du Parti, étaient restés à Buchenwald ou avaient été affectés dans de « bons kommandos » ! Un jour à l'occasion d'un appel qui recommençait sans cesse (c'était une habitude) ce russe m'a présenté au lieutenant de l’armée Joukov. II lui a dit que j'étais pilote de chasse, et c'est ainsi que j'avais 2 copains parmi les russes. Tous les deux étaient parfaitement d’accord pour reconnaitre que nous avions parfaitement raison de les appeler « des primitifs ».
A Harzungen les cuisines préparaient la soupe pour midi. Or la majorité des détenus travaillaient en 3 X 8. Une équipe de 6 à 14 heures, la 2ème de 14 à 22 heures et la 3ème de 22 à 6 heures. Il y avait un décalage de 8 heures tous les dimanches. Théoriquement cela faisait 8 heures de repos, mais en réalité il n'était jamais question de repos. Le premier résultat de ces horaires était qu'on n'avait jamais la soupe chaude qu'une semaine sur 3. Quand on était en équipe de 14 à 22 heures, il fallait alors aller chercher la soupe un peu avant midi, car le départ, ou du moins la mise en colonne avait lieu à midi pour arriver au travail à 14 heures. II ne faut pas oublier qu'on devait parcourir 6 km pour les premiers tunnels et presque 7,5 km pour le 27 et 28 ! Quand on était d'équipe du soir ou du matin, lorsqu'on rentrait, la soupe était froide, et le plus souvent, aigre. Ces horaires pourraient paraître relativement doux, seulement ça marchait rarement aux heures prévues. Car 1'équipe qui était au travail continuait de travailler tant que les remplaçants n'étaient pas arrivés. L'équipe qui arrivait à 14 heures arrivait presque toujours à l’heure, mais celle qui devaient partir à 20 heures et celle qui devait partir à 2 heures du matin partaient rarement à l’heure. A partir du mois d’octobre les alertes étaient presque permanentes, et on ne partait jamais du camp pendant une alerte. Les lumières étant coupées on n'aurait pas pu nous compter ; alors il fallait attendre la fin de l'alerte. Ce n'est pas pour cela qu'on pouvait se reposer ; il fallait rester là, en colonne, sans bouger, qu'il pleuve ou pas. Et on y passait des heures où l'on regrettait de ne pas être dans le tunnel, alors que l’équipe précédente continuait de travailler. Pendant l’automne 44 les choses ont tellement empiré qu'on n'arrivait plus à dormir. En novembre il nous est arrivé de pouvoir dormir (allongé dans notre châlit) 4 heures en une semaine. Je dormais debout, j'avais l’impression que je dormais en marchant. Je n'en pouvais plus. Jusque-là j'avais bien tenu le coup, mais le manque de sommeil m'avait mis complètement à plat, et je n'étais pas le seul.
A propos de compter, un jour, Bigot et moi avons décidé de compter le nombre de fois où nous avons été comptés. Ça variait selon les jours entre 32 et 35 fois.
Tous les mois, en principe, pendant les 8 heures de repos théorique, nous devions passer à la désinfection. II y avait un block pour cela. A l'extérieur il fallait se déshabiller, faire un paquet de ses vêtements et les attacher de façon que le numéro soit visible. Le linge devait passer à l'autoclave, et nous, d'abord au rasage, de la tête aux pieds. Je m'arrangeais pour passer à cette opération avec mon copain Vincent, il avait plusieurs rasoirs, dont un arrachait un peu moins les poils. Ensuite il fallait plonger dans un bain de grésil et ensuite à la douche. Beaucoup de copains craignaient ce bain, surtout les russes et ils se faisaient taper dessus. Personnellement je prolongeais plutôt ce bain, car je sentais que cela nous faisait du bien. Quand nous ressortions, les vêtements n'étaient jamais prêts, et il fallait attendre toujours dehors, à poil. Une fois toute la nuit par -27°. Là j'ai compris comment se passent les mouvements internes d'un essaim d'abeilles : quand on est au milieu on est vite étouffé, et quand on est à l’extérieur on veut revenir à l’intérieur du groupe, parce qu'on gèle, et toute la nuit ça tourne. Cela nous est arrivé aussi en dehors de la désinfection. Chaque fois qu'il y avait un évadé dans l'équipe, on n'avait pas le droit de rentrer dans le block, pendant une nuit, des fois deux nuits. J’ai su plus tard que cette sanction était spéciale à notre block. Ce n’était donc pas les SS qui l’imposaient, mais c’était les tziganes.
Harzungen : les temps changent
Pendant l'été, à part les coups, les vols de nos affaires par les russes et la faim, on pourrait dire que les choses n'allaient pas trop mal, en comparaison de ce qui se passait à Ellrich. Car nous voyions presque tous les jours des camarades d'Ellrich sur le chantier de Woffleben. On voyait bien qu'ils étaient beaucoup plus malheureux et beaucoup plus affamés que nous.
De plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dans le courant de septembre, peut-être même début octobre, tout d'un coup nous avons eu du pain et des pommes de terre à volonté. Était-ce les firmes qui nous utilisaient, qui ont voulu nous nourrir mieux, pour augmenter le rendement ? On ne l’a jamais su. Entre nous, nous disions que c'était parce que la guerre allait finir, et qu'ils voulaient nous remplumer un peu ! Mais, cela aurait dû être pareil partout. Or à Ellrich, nos malheureux camarades continuaient de mourir de faim. Pour croiser ou rencontrer des équipes d'Ellrich il fallait être de l'équipe de 14 à 22 heures, car ceux d'Ellrich travaillaient 12 heures, mais seulement de jour. Alors, lorsque j'ai été de l'équipe de 14 à 22 heures, je mettais un pain de 2 kg sous ma veste, et arrivé sur la plateforme, en passant près d'un groupe d'Ellrich, je criais : « II y a des Français par-là ? ». Des mains se levaient et je jetais le pain dans leur groupe. Je pensais qu'ils devaient être contents, mais qu'ils devaient râler encore plus d'être à Ellrich. Nous étions très peu nombreux à faire ce geste. Deux ou trois tout au plus. Certains copains m'ont même dit : « T'es bien C… de porter ce poids sur 6 ou 7 km pour des gens que tu ne connais pas ».
Cette abondance n'a pas duré longtemps, 10 ou 15 jours tout au plus. Les rations sont redevenues comme avant pour diminuer ensuite progressivement.
Les difficultés de vie étaient très différentes selon les kommandos. Je m'aperçois que je n'ai pas explicité le mot « kommando ». Les Allemands mettaient ce mot à toutes les sauces. II y avait Buchenwald et ses Kommandos, Dora par ex. Mais il y avait les Kommandos de Dora : Harzungen et Ellrich. Et dans les camps, il y avait un tas de kommandos. En général, plus les kommandos étaient petits, et moins mal c'était. A Harzungen le Kommando des électriciens (30 hommes) commandé par Schock alias Bloch, alias Chevalier, était un kommando où tout le monde aurait voulu aller, mais ils étaient 10 pas plus. Personnellement je suis toujours resté dans le même kommando d'abord à Harzungen et puis à Ellrich. Au début quand nous n'étions que 300 environ, nous n'étions pas trop mal, et en plus nous étions transportés par des remorques, puis par un petit train. Quand nous sommes passés à 700, tout a changé, et il a fallu faire le chemin à pied. D'autres kommandos plus petits qui venaient travailler sur un autre chantier ont continué à bénéficier du transport par le train. Au début cette marche ne me gênait pas trop, j'avais beaucoup marché quand j'étais jeune.
En arrivant à Buchenwald, je l’ai déjà dit, nous avions touché les fameuses claquettes (semelle de bois et toile dessus). Au régime où nous étions, avec les kilomètres et les cailloux du tunnel, les semelles ont été vite complètement usées. Aucun rechange n'était prévu, ni pour les vêtements, ni pour les claquettes. Alors on se débrouillait comme on pouvait ; on réparait les claquettes avec des bouts de bois. Au tunnel il y avait partout des planches cassées après utilisation pour les échafaudages, il y avait des clous, et le fameux fil rouge très fin, qui servait à relier les détonateurs entre eux, et qui était forcément perdu après chaque explosion. Ce fil servait à tout, à coudre les boutons, à réparer les pyjamas, à remplacer la ceinture, et à se faire d'autres claquettes. J'ai plusieurs fois découpé des bouts de planche à la dimension de mes pieds, et je fixais ce bout de planche à mes pieds avec le fil rouge. Je crois inutile d'ajouter qu'avec de telles chaussures les marches journalières n’étaient pas de tout repos. Les pieds étaient souvent ensanglantés. Mon ami Gras me remontait souvent le moral, on essayait de marcher à proximité et parfois on s'aidait mutuellement. Mon ami Bigot ne tenait plus tellement le coup, et Gras et moi, l’avons porté littéralement jusqu'au camp plusieurs fois. Par ailleurs vu le peu de temps qu'on passait au camp, il devenait de plus en plus difficile de rencontrer notre ami commun Vincent le coiffeur. II ne pouvait pas nous donner le peu de soupe supplémentaire que nous avions au début. Certains kommandos bénéficiaient régulièrement d'une distribution d'ersatz de café, de confiture ou d'une rondelle de saucisson. Pour nous, au début, en juin-juillet et même août, nous y avions droit, mais après il ne fallait pas y compter. Nous avions tout juste la soupe, froide et souvent aigre, et le pain à couper en 4, puis en 6, et puis en 8.
Nu comme un ver ... et ce n'était pas au paradis terrestre
Les appels devenaient de plus en plus longs et pénibles. Les petits kommandos avaient vite fait, et pouvaient aller se coucher, mais pour nous, cela durait des heures et des heures toujours prises sur notre temps de sommeil bien entendu.
Il y avait bien parfois de petits incidents qui nous amusaient, par exemple au tunnel 27 les deux posten (sentinelles) qui gardaient l’entrée du tunnel étaient des braves bougres, anciens de la Luftwaffe, qui faisaient juste le nécessaire pour ne pas partir sur le front russe, mais ce n'est pas eux qui auraient volontairement frappé un déporté. Lorsqu'au début je poussais le wagonnet, il m'était arrivé de leur parler un peu, souvent par le truchement du russe (écrivain public) qui surveillait le compresseur. Ils avaient appris que j'étais officier pilote de chasse, et ils avaient un grand respect pour moi. Après, quand on partait en colonne pour aller au boulot, les « posten » nous attendaient à la sortie du camp en 2 rangs de part et d'autre de la sortie. Et tous les X rangs de détenus, un posten se détachait pour nous surveiller. Alors, comme je m'arrangeais autant que possible pour partir en début de colonne, je passais devant les deux que je connaissais, et chaque fois qu’ils me voyaient, ils rectifiaient la position pour me saluer. Je répondais par un imperceptible coup de tête, qu'eux seuls pouvaient voir. Cela amusait beaucoup mes copains Coquelle, Gras, les belges qui faisaient partie de notre équipe, et surtout Bigot. II les voyait souvent avant moi, parce que cela l'amusait plus que moi et il disait très haut : « Et les gars, regardez les potes à Bébert. Ils vont se mettre au garde à vous ! ». Les 2 sentinelles rectifiaient discrètement la position. Leurs copains ne s'en sont jamais aperçus. Mes copains à moi riaient bien intérieurement, mais assez discrètement pour que « les autres » ne remarquent rien.
Au fur et à mesure que les nuits sont devenues plus longues, le supplice des appels prolongés et vexations diverses devenait de plus en plus pénible, et nous disions déjà : « Mais quand on rentrera en France et qu'on racontera ça, personne ne voudra nous croire ». A cette époque nous ne savions pas que la situation aller se dramatiser beaucoup plus. Passer la nuit dehors, sous la pluie, ou complètement nu, alors qu'il gelait très fort, nous paraissait tellement odieux, que nous ne pouvions imaginer pire... et pourtant nous avons vu pire. En octobre et surtout en novembre le nombre de morts augmentait régulièrement. Nous avions tous terriblement maigri. Ceux qui étaient un peu plus âgés et qui étaient un peu gros avant leur arrestation, avaient fondu. La peau de leur ventre tombait devant, si bien qu'on ne leur voyait pas ce que vous pensez. On disait qu'ils avaient « le tablier ». Cela ne nous amusait pas tellement. Je crois l'avoir déjà dit, on nous faisait mettre à poil, sans rime ni raison, et cela ne nous faisait pas rire du tout.
Beaucoup de camarades avaient attrapé la dysenterie, et cela n'arrangeait rien. On voyait quand un camarade n'avait plus que quelques jours à vivre : ses chevilles enflaient, puis le mollet, puis au-dessus et c'était la fin. Ceux qui tenaient le mieux le coup étaient âgés de 25 à 35 ans, ce qui était mon cas.
Malgré cela, en novembre, j'étais à bout de forces. Pendant 3 semaines, nous n'avons pu dormir qu'une vingtaine d'heures en tout. Je dormais debout, je n'en pouvais plus. Le 30 novembre, en rentrant du tunnel j'ai aperçu un français que je connaissais à peine, mais je savais qu'il travaillait à l'arbeitsstatistik, c'était Coty (54) (de la famille des parfumeurs). Il m'a fait signe de venir le voir. Bien entendu j'y suis allé, et il m'a dit que les déportés qui seraient « trop nus » n'iraient plus au tunnel. Pour rejoindre les tunnels, il fallait traverser le village de Woffleben, et comme nos vêtements étaient complètement usés, totalement en lambeaux, certains de nos camarades ne pouvaient pas cacher « leur nudité ». La population avait protesté auprès des SS à cause des enfants, etc. Coty m'a dit : « Je ne crois pas que ce soit dangereux, parce que des vêtements neufs sont attendus. Ça te permettra de te reposer un peu ». Je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Au moment du départ suivant, je me suis présenté à l’appel… complètement à poil. Je n'avais pas chaud, mais je m'étais déjà habitué. Le kapo m'a fait sortir des rangs et m'a renvoyé au block. J'avais signalé ce que m'avait dit Coty à mes meilleurs copains, mais ils n'ont pas osé faire comme moi. Ils ont eu tort. J'ai passé à poil tout le mois de décembre. Je voyais tous les jours mon ami Vincent, qui me refilait une soupe, et j'ai repris des forces. Curieusement, le stubendienst, qui m’avait tant frappé jusque-là m'a fichu une paix royale. J'ai pensé qu'il avait peut-être bien peur que je le coince dans un coin, sans témoin, et comme j'étais beaucoup plus fort que lui … il a dû réfléchir ; je ne le voyais jamais quand les autres n'étaient pas là.
____________________
(54) Henri Sportuno-Coty (1922-2007), résistant déporté à Buchenwald, libéré à Bergen-Belsen
Aux tunnels !
En juin et juillet ce n'était pas trop pénible au tunnel 27 où j'étais affecté. Comme je l'ai déjà dit, c'est notre équipe (une douzaine), qui a ouvert le chantier. On devait creuser un tunnel classique pour une voie ferrée. Il faisait environ 6 mètres de large et 5 mètres de haut. II devait s'enfoncer droit dans la montagne et tous ces tunnels y étaient parallèles.
Les équipes venues d'Ellricht et qui travaillaient de jour ont posé des buses au fond du ruisseau. Nous étions trois équipes qui faisaient chacune 8 heures. Je vidais consciencieusement mes wagonnets dans la pente et petit à petit le ruisseau se comblait pour former plus tard une vaste plaine avec gare de triage et 28 voies ferrées qui rentreraient dans la montagne. Tant qu'il n'y a eu que la petite voie étroite genre Decauville, les rails étaient légers, nous étions tous encore en pleine forme, et en plus on nous transportait à 1'aller et au retour, au tout début avec le tracteur et les remorques, et après avec un train. Mon ami Vincent ayant été affecté au kommando des coiffeurs, c'est un jeune de Saint-Claude, qui l’avait remplacé. II était très sympa. Jamais il n'a dit que s'il était là c'était la faute des résistants, comme certains autres. Il était costaud, mais très jeune, à peine 20 ans, je l’ai pris en amitié.
Dans ce tunnel, à cette époque, il y avait donc Bigot, ce jeune dont j'ai malheureusement oublié le nom, trois ou quatre belges, le russe écrivain public, un salopard de tchèque (j'y reviendrai) et quelques polonais.
Nous avons ainsi creusé sur une centaine de mètres. II n’y avait que deux perforatrices, et elles perçaient des trous de 4 mètres de profondeur. II fallait ensuite remplir les trous d'explosifs, mettre un bâton avec le détonateur, encore 2 bâtons d'explosifs et puis des bâtons de terre glaise sur lesquels ont tapait un peu pour bien obturer les trous. Le meister reliait les détonateurs entre eux avec ce fil rouge si utile à tous. On sortait et le meister déclenchait l'explosion. II fallait rentrer rapidement pour reprendre le boulot, mais enfin, tant que le tunnel n'était pas profond, on respirait à peu près. II n'y avait guère que la poussière des perforatrices, c'était supportable. Pour gagner du temps, pour remplir le wagonnet, ils avaient imaginé un petit engin qui n'était pas mal du tout ; c'était comme un petit tracteur, mais il fonctionnait à l'air comprimé. II avait une pelle basculante à l'avant, elle était portée par 2 bras latéraux. Cette pelle passait par-dessus la tête du conducteur, et vidait les cailloux dans le wagonnet. Naturellement le conducteur de cet engin devait viser pour que la pelle vide bien la pelletée dans le wagonnet. Je me suis dit que si cet engin marchait bien, mon travail devrait s'accélérer. C'est un jeune belge qui a été désigné pour conduire cet engin. II avait à peine 20 ans. C'était un garçon très gai et très sympathique. Les meister et plusieurs ingénieurs sont venus voir fonctionner l'engin, et l'un de ces visiteurs a même félicité le jeune belge pour son adresse dans la conduite de cette mini-pelle mécanique. Cette pelle a travaillé environ 3 jours. Un énorme bloc de rocher, pesant plus de 500 kg s'est détaché de la voûte, et il est tombé en plein sur le jeune belge et son engin. Nous étions tous effarés, nous, par la mort de notre copain, et les boches parce que leur petite merveille était en morceaux. Nous tentions de sortir le cadavre de notre camarade. C'était le premier mort de notre kommando, si jeune et si sympa ! Nous étions tous, même les russes, hébétés, et bien entendu nous avions arrêté de travailler. Un meister qui était venu voir les dégâts (pas le nôtre) s'est mis à taper dans le tas, en hurlant : « Arbeit, arbeit ! » et il a ajouté quelque chose que je n'avais pas saisi. C'est un copain belge qui me l'a traduit après. II avait dit : « Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit mort ? vous ne comptez tout de même pas revoir la France, par hasard ? ». Personne ne nous avait encore dit cela aussi crûment, ajouté à la peine causée par cette mort. Nous n 'avions aucune envie de plaisanter, en revenant au camp.
Notre meister était parait-il autrichien, il devait approcher la soixantaine et il n'était pas en admiration devant Hitler. D'ailleurs on reconnaissait de suite ceux dont on devait se méfier. Il y avait d'abord les vrais SS. Au camp il y en avait très peu et aux tunnels ils étaient nombreux, mais comme ils soignaient leurs poumons, on les voyait rarement dans les galeries. Sur l’immense esplanade, il fallait s’en méfier. Il fallait aussi se méfier de tous les civils qui avaient un brassard rouge avec la croix gammée. Je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi beaucoup de civils avaient ce brassard, et les autres pas. Mais nous avions tous compris que nous n'avions pratiquement rien à craindre des civils qui ne portaient pas de brassard, mais que par contre il fallait toujours passer à bonne distance de ceux qui portaient ce fameux brassard.
Notre meister était bien brave, mais il avait peur de se faire engueuler. Alors il répétait inlassablement : «Los, los, los ! (55)» Nous l’avions baptisé « l'os à moelle ». Je ne l'ai jamais vu frapper un déporté.
Tous les quinze jours, en principe, mais d'une manière très irrégulière en réalité, dans les tunnels il y avait une distribution de cigarettes. C'est un ingénieur de la firme chargée des travaux qui les distribuait lui-même à ceux qui avaient bien travaillé. Je dois dire que le meister aurait bien voulu que je prenne la pelle et que je charge le wagonnet avec les autres. J'avais refusé, je lui avais dit que j’étais officier français, Convention de Genève, etc. J'acceptais de pousser le wagonnet, c'était déjà pas mal. Le meister nous a fait mettre en rang, et dans l’ordre : en premier le tchèque, puis des polonais et ainsi de suite. Je m'étais mis le dernier sans attendre qu'il détermine ma place, et j'avais même laissé un bon intervalle, entre l’avant-dernier et moi. Je me foutais bien des cigarettes, je ne fumais pas. L'ingénieur a commencé sa distribution, il a donné 3 cigarettes au tchèque, 2 aux suivants, et une aux autres. Puis voyant l'espace que j'avais laissé… Il a demandé au meister : « Et celui-là ? ». Le meister est parti dans un grand discours, duquel j'ai compris qu'il disait à peu près ceci : « Oh celui-là, il ne fout rien ; il consent à pousser le wagonnet pour aller le vider dehors, parce que ça lui permet de respirer mieux, mais refuse de manier la pelle. Il dit qu'il est officier et qu'il n'a pas à travailler, alors, pas de cigarettes ». L'ingénieur s'est approché de moi et dans un français impeccable il m'a dit : « C'est vrai que vous êtes officier ? » « oui, Lieutenant » « Quelle arme ? » « Aviation, pilote de chasse, etc. » « et pourquoi êtes-vous ici ? » « J’ai été arrêté par la Gestapo ! etc. ». Il est resté là un bon moment, et il m'a demandé un tas de détails. Je lui répondais gentiment, mais toujours en gardant une certaine raideur. Ça devait faire bien ! L’ingénieur m'a donné tout ce qui restait dans le paquet, il y avait bien une dizaine de cigarettes. Le meister était un peu gêné, mais il n'a rien dit. Le tchèque qui travaillait bien s’agitait dur, il était furieux. Le plus extraordinaire, et qui peut paraître incroyable dans un camp de concentration, c'est que cet ingénieur m'avait pris en amitié. Quand on arrivait de jour sur l'esplanade je le voyais de loin, je me mettais sur le côté de la colonne. Sans avoir l'air de rien il se rapprochait de la colonne, et au moment où je passais près de lui, je n'avais qu'à écarter un peu la main, et il me glissait parfois un peu de pain ou des cigarettes ou un morceau de saucisson. Personne n'y voyait rien. Même si un SS surveillait, il n'avait aucune possibilité de voir ces gestes tant c'était discret. Quand je le voyais de loin, je lui adressais un petit signe de remerciement, et il faisait lui-même un petit signe qui voulait dire : « Courage ! » Non, tous les boches n'étaient pas des salauds !
Lorsque le tunnel 27 a été creusé sur une centaine de mètres la belle époque s'est achevée. II a fallu attaquer sur le côté droit une première salle qui allait relier le 27 au 26. Ces salles étaient beaucoup plus larges et plus hautes, environ 15 à 18 mètres de large et près de 10 mètres de haut. La vallée était aplanie jusqu'au niveau des tunnels. La gare de triage s'installait sur cette immense esplanade. Une voie ferrée à voie normale est entrée dans notre tunnel. Les rails étaient montés sur leurs traverses, à l'extérieur, sans doute par des déportés d'Ellrich. Mais c'est nous qui devions les porter et les mettre en place, à l'intérieur du tunnel. Ils ont appelé des déportés des autres tunnels pour nous aider (et réciproquement). Il fallait se mettre à quatre à chaque traverse, soulever le total et marcher, jusqu'à l’emplacement définitif. C'était terrible. Le meister nous expliquait que tout était calculé et que cela ne faisait que 50 kg par détenu. Peut-être, mais il y en a un qui ne voulait pas forcer, et d'autres qui ne pouvaient pas ! Pour ce travail il y avait un tas de civils et même des SS, qui venaient nous « encourager ». Ça pleuvait de tous les côtés. Comme j'ai toujours eu les épaules plus larges, j'étais toujours bon pour récolter le maximum de coups. Ils ne frappaient pas les petits qui ne portaient parfois rien, mais moi j'avais l’impression qu’ils se mettaient à 4 pour me taper dessus, que j'aurais dû porter la voie ferrée à moi tout seul ! Etant jeune, j'avais pratiqué tous les sports, surtout le cyclisme (j'avais été champion de l’Aveyron), mais j'avais aussi fait beaucoup de natation, de la boxe, des poids et haltères et même du trapèze volant. J'avais maigri depuis mon arrestation, mais j'étais encore en possession de toutes mes forces. J'avais à mon tour expliqué aux français et belges, que là il n'était pas question de saboter ou même de se ménager et qu'il fallait absolument y mettre tous sa meilleure bonne volonté, sous peine de crever sous les coups. Mon pote écrivain public a expliqué la même chose aux « primitifs ». Finalement après quelques tentatives infructueuses, et les « encouragements » de tous ces salauds, on finissait par soulever ce morceau de voie et le porter à sa place. J'avais les épaules en sang des coups que j'avais reçus. J'en arrivais à regretter d'avoir les épaules plus larges que mes copains, parce que j'en aurais pris moins. Arrivé presque au bout du tunnel, il a fallu mettre en place l'aiguillage qui permettrait soit de continuer tout droit, soit de tourner dans la salle de droite. Les rails devaient je pense être un peu plus légers que ceux d'une voie normale de chemin de fer, mais quand il a fallu soulever l'aiguillage, ils ont eu beau nous taper dessus, il est resté collé au sol. Alors ils ont fait venir des détenus d'un autre tunnel, ils ont passé des poteaux (ceux qui servaient pour les échafaudages) sous les rails, ajouté 10 ou 12 détenus, pour soulever le tout, et on y est arrivé… non sans mal ! Mais je garde un très mauvais souvenir. Et c'est bien le seul cas où j'ai mis toute ma force au service du grand Reich !
Quand le tunnel a bifurqué, c'est notre équipe qui s'est attaquée à la grande salle. Elle a même été renforcée. C'est une autre équipe qui a continué à creuser tout droit. Tout notre kommando et l’effectif de notre block a doublé. Pour notre grand malheur, notre meister « l'os à moelle » a continué tout droit, et c’est un nouveau meister qui nous a pris en compte. II avait le brassard rouge avec la croix gammée. II respirait la cruauté et la méchanceté. II avait des yeux de murène ! En le regardant, je me disais que, celui-là, si un jour je le retrouvais... même dans 50 ans je reconnaîtrais ses yeux ! II arrivait en même temps que nous, et la première chose qu'il faisait était de démonter une pioche, il rangeait quelque part la partie métallique, et il conservait le manche dans une main. II n'avait pas le classique « goumi ». Avec lui c'était le manche de pioche. J'en ai tâté dès le premier jour et j'ai jugé inutile de lui dire que j'étais officier et que, etc. Je l'ai vu tuer net un polonais et occire 2 belges, qui sont morts peu après.
Lorsque nous avons attaqué la salle perpendiculaire au 1er tunnel et que la voie ferrée à écartement normal a été mise en place, la méthode de travail a changé. Ce n'était plus le wagonnet sur voie Decauville qu'il fallait remplir à la pelle. II y avait une énorme pelleteuse fonctionnant au mazout qui remplissait un wagon normal, qu'une locomotive poussait au plus près, et qu'elle venait rechercher lorsqu'il était plein. La pelleteuse lançait à la voûte une épaisse fumée noire qui se mélangeait à la poussière des perforatrices et nous devions respirer ce mélange ! La visibilité ne dépassait jamais dix mètres, et parfois on ne se voyait plus à un mètre cinquante. Je ne poussais plus le wagonnet. J'avais dû prendre la pelle ou les pioches qui ne manquaient jamais. Dehors il faisait encore chaud, mais dedans il faisait très froid.
Bien sûr, quand on n'arrêtait pas de manier la pelle on se réchauffait. Personnellement, et je n'étais pas le seul, je travaillais efficacement quand le meister était dans mon dos ou risquait de me voir, mais dès qu'il avait tourné le dos, je m'appuyais sur le manche de ma pelle, et si j'avais froid, je remplissais ma pelle à ras bord, mais au lieu de jeter les cailloux dans le wagon, je les jetais contre la paroi. Cela amusait mes copains, même les « primitifs », mais cela agaçait le tchèque, je voyais qu'il était furieux contre moi. De plus, à Buchenwald, quand on nous avait mis à poil et pris toutes nos affaires, j'avais sauvé mon alliance et ma montre. Jusque-là j’avais réussi à les passer au travers de toutes les fouilles. J'avais cousu mon alliance dans la doublure, autour d'un bouton, et j'avais toujours gardé ma montre, en la camouflant comme je pouvais. Au tunnel tout le monde avait vu que je donnais l'heure aux franco-belges, et même les primitifs me demandaient quand l'heure de la relève approchait pour combien de temps on devait encore pelleter. Cela rendait bien service à tous les bagnards, mais le tchèque s'est dit qu'il pouvait tirer parti de cette situation ! Ce salopard m'a dénoncé au chef de block, lequel n'avait pas de montre… Il m'a convoqué, et m'a dit : « Je te donne le choix, ou je dis aux SS que tu as une montre, et tu prendras les 25 coups, et ils te prendront ta montre, ou tu me la donnes, et tu auras droit à une gamelle de soupe ». En fait de choix, c'était plutôt limité, alors je lui ai dit que je lui donnais ma montre. Je crois l'avoir déjà dit, le chef de block était un tzigane, de corpulence moyenne, mais il voulait faire très distingué : cheveux noirs ondulés, etc. On disait qu’il était P.D. et qu'il se tapait le stubendienst… Je n'ai jamais vérifié. Le lendemain, je suis allé chercher ma gamelle de soupe « en rab » et il me l’a donnée. Le lendemain encore, j'ai essayé, mais il m'a envoyé sur les roses. Le tchèque par contre est devenu kapo. Heureusement pour moi, il était affecté à d'autres équipes et je ne l'ai revu que de loin.
Je n'avais plus de montre. Les collègues, et même les russes en étaient désolés. Le meister était aussi mauvais que le premier jour et je commençais à me dire que si la guerre devait continuer encore un hiver je risquais d'y laisser ma peau. J'ai décidé de m'évader. J'ai tâté quelques copains, mais aucun n’a marché, trouvant qu'avec notre pyjama rayé de bleu, les claquettes déjà beaucoup usées, sans le sou, et tout le reste, les chances étaient trop réduites. J'ai échafaudé mon plan pour partir tout seul. Pour sortir du tunnel, j'avais trouvé un moyen relativement facile : la pelleteuse remplissait le wagon de cailloux, et les pelleteurs, dont moi-même, remplissions les bords et les angles. La plateforme extérieure n'était plus gardée à la sortie de chaque tunnel et les wagons étaient vidés je ne sais où, mais sûrement en dehors de l’enceinte des barbelés et des miradors. J’ai su plus tard qu’il y avait une rangée de barbelés électrifiés et des miradors sur un coude à 30 km de Dora, c’est pourquoi tous les évadés étaient repris 2 ou 3 jours plus tard. Je m'étais dit qu'en me cachant dans un angle du wagon, lorsqu'il serait presque plein, il suffisait qu'un copain me jette une vingtaine de pelletées de cailloux dessus pour que je sois bien caché. Je m'arrangerais pour que les cailloux ne m'empêchent pas de respirer. Le moyen de sortir du tunnel me paraissait facile. Mon copain Bigot avait accepté de me recouvrir de cailloux.
Pour m'évader, il ne suffisait pas de sortir de l’enceinte des tunnels ! Après, il y avait au moins 400 bornes, sans compter les détours, à faire à pied et sans être vu. Je ne me bouchais pas les yeux, mais j'espérais avoir la chance de trouver des chaussures et peut-être des vêtements. Je me disais que pour manger, après le 15 août, on trouve des fruits un peu partout. Et puis, j'avais ma spécialité d'apiculteur. Je savais qu'après le 15 août, beaucoup de ruches seraient pleines de miel. Si j'avais disposé d'un simple enfumoir ce ne me serait pas très difficile, mais je n’avais pas d’enfumoir. Je ne crains pas les piqûres, et pour récupérer 2 ou 3 kg de miel, j'étais prêt à prendre un millier de piqûres, je savais que cela ne risquait pas de me rendre malade. Pour trouver des ruches, pas de problème ; à cette époque, il y en avait à proximité de presque toutes les fermes. Je me disais qu’en choisissant la date du 15 août, la bonne Mère me donnerait sa bénédiction, et… je n'attendais plus que le 15 août.
Le 13 août, je rêvais à mon évasion prochaine, le meister était sorti prendre l'air, et je dormais peut-être un peu, appuyé sur le manche de ma pelle. Ce salopard est rentré, et avant que j 'aie le temps de le voir, j'ai reçu sur ma jambe gauche une pioche complète, le manche, et le fer avec. La pointe m'a touché sur le tibia de la jambe gauche, ça saignait beaucoup, et en bougeant la peau, j'ai vu 1'os… il n'était pas cassé, mais cela me faisait un mal horrible. Et j'ai dû me remettre à pelleter. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je pouvais dire adieu à mon évasion. Pour rentrer au camp, heureusement on avait encore le petit train, je n'aurais jamais pu faire les 6 km à pied. En arrivant au camp je suis bien allé voir le Dr Desprez, espérant entrer à l’infirmerie, mais il m'a dit qu'il n'y avait réellement plus de place, et qu'il ne pouvait pas m’admettre pour une blessure. Pire il n'avait absolument rien pour désinfecter la plaie, ni pour faire un pansement. II me fallait attendre (et continuer de travailler) mais il m'a dit de revenir dans 8 jours et qu 'il aurait alors quelque chose pour désinfecter. En attendant, j'ai fait comme les copains qui se blessaient : je prenais de la poudre pulvérulente crachée par les perforatrices et je m'en servais comme d'un onguent, puis j'enveloppais avec du papier de sac de ciment, et j'enveloppais le tout en l'attachant avec le fil rouge des mines. Huit jours après je suis retourné au revier, Desprez m'a plongé une espèce de crayon dans la plaie, il a tourné pendant une minute, et il m'a dit : « Maintenant ça ne s'infectera pas ! ». J'ai eu très mal pendant une ou deux heures, mais la plaie ne s'est pas infectée. Cette plaie n'a pas guéri non plus. J'en ai souffert jusqu'à mon retour en France où un médecin de Romorantin, m'a enfin soigné pour qu'elle se ferme.
Au tunnel un des foreurs a disparu, je ne sais pourquoi et le meister a demandé un volontaire pour le remplacer, et se charger d'une perforatrice. Tout le monde avait peur de cet engin trépidant, moi aussi mais mon pote russe écrivain public, qui avait été classé foreur depuis quelques jours m'a cligné de l'œil d'une certaine façon, qui voulait dire : « Viens ce n'est pas si mauvais !». Je me suis présenté volontaire et le meister n'a montré comment on devait opérer avec la perforatrice. Heureusement pour nous, cette terreur de meister avait les poumons fragiles, et il n'a pas tardé à aller prendre l'air. Alors mon pote russe m'a montré comment il fallait faire avec la foreuse, pour avoir l'air de pousser très fort, alors qu'en réalité on dormait doucettement accrochés à l'engin. Et il a ajouté, demain je te montrerai comment on bousille la machine, et qu'on casse les mèches. Effectivement le lendemain, il a surveillé quand le meister sortait et il m'a montré. Toutes les heures on devait graisser la machine. Pour cela il fallait couper 1'arrivée d'air comprimé, ouvrir la machine et avec une grosse burette il fallait vider un verre d'huile à l'intérieur. Le russe a ainsi préparé la machine et il m'a fait signe de bien regarder. Il a pris une bonne poignée de poussière de pierre et il l'a consciencieusement vidée dans le mécanisme avec l'huile par-dessus. Une ½ heure après, la machine était morte.
Puis le russe m'a montré comment casser les mèches. Il fallait attendre d'en avoir une longue. Casser des petites cela n'avait aucun intérêt, il y en avait en pagaille, mais casser une mèche de 6 mètres, surtout quand on avait presque fini les 6 mètres, là ça valait la peine. Quand on commençait un trou on prenait une mèche de 1 mètre 50 et puis une de 3, puis 4 ou 5 et pour finir avec une de 6 mètres.
Au début, tant qu'on était près de l'entrée, ils ne foraient qu'à 4 mètres, et après, lorsqu'on était largement sous la montagne, on forait à 6 mètres. Le long de la voûte, on faisait un trou tous les 50 centimètres, et dans le reste de la paroi, on forait seulement tous les mètres. Les foreuses devaient être portées à bras tout au début, quand on commençait le trou, puis on posait la machine sur un pied équipé d'un petit vérin pneumatique qu'on commandait en tournant la poignée. Une fois l'engin posé sur ce pied, on ne forçait plus du tout. Et mon pote russe m'a montré qu'en ouvrant la pression d'air au bon moment, la mèche se cassait, sans discuter. Il fallait recommencer un autre trou à côté du premier et pour peu qu'on ait la chance que le 2ème trou rencontre le premier, c'est la 2ème mèche qui cassait. Les leçons de l'écrivain public ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd, et entre moi et les autres, deux mois plus tard, ils ne pouvaient plus forer à 6 mètres parce qu'ils n'avaient plus de mèches de cette longueur.
Quand on avait fini de forer, il fallait garnir les trous de dynamite. Au début c'était les foreurs qui faisaient ce travail. II fallait mettre des saucissons de dynamite jusqu'à un mètre environ de la sortie, puis on mettait un bâton avec le détonateur, on laissait sortir les 2 fils, puis on rajoutait encore un ou deux bâtons de dynamite et on bouchait avec des bâtons de terre glaise préparés d'avance. Evidemment le meister surveillait l’opération, mais je ne suis dit que si je prenais un bâton de terre glaise à la place d'un de dynamite, il ne pouvait guère voir, et je glissais ce saucisson juste avant de mettre celui avec le détonateur. J'ai fait cela sur 4 ou 5 trous rapprochés les uns des autres. Après l'explosion, un énorme bloc était resté collé à la paroi, et ils ont bien dû se rendre à l'évidence… les mines n'avaient pas explosé à cet endroit. Il a fallu forer en biais et au fond, là où il n'y avait pas de dynamite pour faire sauter cette masse. Tout le monde se demandait pourquoi une telle chose avait bien pu se produire J'ai pris dans un coin mon pote russe et je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Pour une fois c'est moi qui lui apprenais un sabotage. Le jour suivant il y a eu non pas une mais deux énormes bosses qui n'avaient pas explosé. Les ingénieurs ont compris pourquoi, mais ils n'ont pas fait d'histoires ; je crois bien ils n'ont pas alerté les SS, et à partir de ce moment-là ce sont les ingénieurs et les meisters qui remplissaient les trous. Nous, pendant ce temps… on se reposait.
On avait beau saboter, les travaux avançaient quand même, et vite. Théoriquement chaque équipe de 6 heures aurait dû creuser les 6 mètres et faire sauter. Grâce au sabotage on faisait sauter 6 mètres seulement une fois par 24 heures. Malgré cela, les premières salles étaient terminées dès le mois de septembre. Tous les 28 tunnels étaient reliés entre eux par des salles immenses. Et on attaquait les suivantes !
En novembre on avait presque fini la deuxième salle, le meister cognait toujours autant, mais peut-être un peu moins sur les foreurs. Avec mon ami russe on cassait les mèches de 6 mètres chaque fois qu'on nous en donnait une, et on usait des machines, sans doute plus que dans les autres tunnels. Le meister devait se douter de quelque chose. Un jour, il a fait semblant de partir prendre l'air, mais il est revenu immédiatement, et il m'a vu en train de mettre l'abrasif dans la perforatrice... moi aussi je surveillais, et je l'ai vu en même temps qu'il m'a vu. C'était tout en haut de l’échafaudage, on y voyait à 2 mètres pas plus. En ¼ de seconde, j'ai réalisé que si je ne disparaissais pas instantanément je ferais partie des pendus du dimanche matin. C'était rituel, le dimanche matin, pendant les 8 heures de soi-disant repos, il fallait assister à la cérémonie, musique en tête. II y avait une musique dans tous les camps tziganes qui ne faisaient que ça. Et on pendait les saboteurs, par cinq de préférence. voir ci-après le dessin réalisé par un déporté montrant les pendaisons par 5.
Je savais qu'il y avait des « bigues », poteaux plantés en biais pour maintenir l'échafaudage plaqué contre la paroi. D'un bond, j’ai passé une main autour d'une de ces bigues et j'ai plus ou moins glissé contre, ce qui a freiné ma chute. Le meister m'a jeté une masse à casser les cailloux ; cette saleté de masse a encore touché ma jambe malade mais j'ai à peine senti la douleur, tant j'étais pressé de filer. Je suis allé dans la première salle transversale. J'en ai traversé 5 ou 6 de ces salles, jusqu'à ce que je trouve un cadavre. Car je savais bien que le meister avait mon numéro, et qu'il allait me faire rechercher lors de l'appel. Le cadavre que j'ai trouvé était celui d'un russe. Bonne affaire ! j'ai enlevé sa veste, je lui ai soigneusement enfilé la mienne et j'ai traîné loin du tunnel 27 jusqu'au départ. On a appelé le 52 278 et au bout d'un moment les SS ont regardé le numéro du mort, c'était le 52 278 ; tout allait bien, on a pris la route du camp. Mon meister a dû croire qu'il m'avait touché avec la masse et que j'étais allé mourir dans un coin. Pour le moment j'étais tranquille, mais j'avais intérêt à ne pas retomber sur lui.
Pour une fois j'ai eu de la chance. J'ai interrogé les copains qui travaillaient dans les tunnels du début, vers le 5 ou le 6, et ils m'ont dit qu'au 5 je crois il manquait du personnel, et que de plus leur meister avait eu un accident (encore une pierre tombée du plafond mais qui pour une fois avait bien choisi son point de chute). Ils m'ont dit : « Le meister sera nouveau, alors tu peux bien venir avec nous ! ».
Je suis allé au tunnel 5, et là j'ai eu une chance extraordinaire. Le nouveau était jeune, la trentaine, comme moi, mais de toute évidence, il n'avait jamais vu des foreuses en action, il a été pris d'une trouille incroyable : je l’observais mine de rien et je voyais qu'il tremblait. J'ai fini le trou qui était commencé, consciencieusement, sans casser la mèche de 6 mètres. II a fallu attaquer un nouveau trou. D'habitude c'était le meister qui marquait la place exacte du trou à percer, et c'était lui qui tenait le bout de la mèche pendant que le trou commençait à se former. Alors j'ai demandé au meister où je devais commencer, il m’a fait signe... : « par-là ! ». D'un air de dire : « Tu le sais mieux que moi ! ». Je l'ai bien regardé, il avait un petit air pitoyable, et bien sûr il n'avait pas le fameux brassard rouge. Je me suis dit que de toutes façons j’avais intérêt à ne pas me faire remarquer. Alors, je lui ai bien fait remarquer qu’il fallait deux hommes pour commencer un trou. Il m'a dit d'aller chercher un copain à l'étage en dessous. Je lui ai répondu que ça prendrait trop de temps. J'ai alors monté sur ma foreuse une mèche très courte, et à la force des poignets, j'ai maintenu tout seul, la mèche au bon endroit… Je me suis débrouillé tout seul. Alors il est parti un moment et il est revenu avec un morceau de pain. Puis il m'a expliqué qu'il revenait du front russe où il avait été blessé, et que sorti de l'hôpital il n'avait aucune envie de retourner voir les russes. Alors on avait demandé des spécialistes mineurs et il avait dit qu'il était « mineur » mais en réalité c'était bien la première fois qu'il voyait des perforatrices et les échafaudages et tout le reste. II m'a pratiquement supplié de l'aider. Il m'a dit de prendre le commandement de l’équipe du tunnel, enfin, de tenir sa place.
Pour une fois, je n'ai pas fait comme j'avais fait à Buchenwald avec Marcel Paul, et j'ai accepté. C’est moi qui commandais les autres, ils ne s'en plaignaient nullement d'ailleurs, bien au contraire, seulement le tunnel n'avançait guère. Mais déjà à cette époque une pagaille générale s'installait partout, et à part les tunnels dont le meister portait le brassard rouge, qui eux continuaient d'avancer, tous les copains racontaient que leurs meisters passaient leur temps à discuter à l'air libre, et qu'ils ne les voyaient presque plus. Mon nouveau meister m'apportait tous les jours un petit morceau de pain et il s’excusait que le morceau soit si petit mais que sa ration n'était pas grosse et que toute l’Allemagne crevait de faim.
J'ai travaillé ainsi, en suppléant partiellement le meister, pendant une quinzaine de jours. Lui se mettait au courant de tout, et à l'extérieur, il avait bien dû se renseigner avec ses collègues, sur tout ce qui se passait au tunnel, il était devenu un meister tout à fait convenable. Quant à moi, je ne faisais guère d'efforts au travail mais il y avait le chemin à faire, la nourriture se raréfiait au camp, mes vêtements étaient en lambeaux, mes chaussures n'étaient que des planches avec 3 clous de chaque côté pour attacher le fil des mines. Et puis surtout, il y avait des alertes sans arrêt, la relève n'arrivait pas, on ne dormait plus, ma jambe me faisait atrocement souffrir, et lorsque Coty m'a signalé que le lendemain, ceux qui seraient trop dévêtus n’iraient pas au boulot... je me suis mis à poil et j'ai déjà expliqué la suite.
Pendant le mois de décembre que j’ai passé complètement à poil, j'ai bien essayé de faire soigner ma jambe, mais les Desprez n'avaient rien pour ça. Mon copain Vincent me passait un peu de soupe, j'allais quelques fois, en me couvrant d'une couverture (il en restait 3 pour tout le block) jusqu'au block des électriciens. Ils m'ont donné une soupe 2 ou 3 fois mais ils n'avaient guère d'excédents. Ils étaient mieux nourris que les équipes de foreurs, mais ils n'étaient pas gras quand même, mais je dormais enfin, je me reposais, ma jambe me faisait moins souffrir. Tout allait beaucoup mieux pour moi.
Le 31 décembre est arrivé et des vêtements neufs aussi. J’ai été convoqué et j 'ai reçu un pyjama neuf, avec caleçon, chemise, un pull - c'était le premier - et des claquettes neuves. Le 1er janvier je suis reparti aux tunnels presque joyeux.
J'ai bien essayé de revenir avec le dernier meister que j'avais eu et que j'appelais « le bon meister ». Je n'ai pas réussi à me faire affecter avec lui, mais dans un tunnel perpendiculaire, tout près.
Le travail était encore plus calme que fin novembre. Les bombardements s'accentuaient, et les boches avaient peur. Il arrivait qu’en plein jour on voit le ciel littéralement couvert d'avions. Impossible de les compter, mais on se disait : « Là où ça va tomber, ils vont comprendre ». Du ciel tombaient des nuées de bandelettes métallisées extrêmement fines, et on se demandait à quoi cela pouvait bien servir. Des copains me demandaient ce que c'était, et j’étais bien incapable de leur expliquer exactement à quoi cela pouvait servir. J'avais compris que ça avait un rapport avec des ondes hertziennes, qu'elles avaient certainement ¼ de la longueur d'onde de certaines transmissions, je disais aux copains que c'était sans doute pour tromper les gonios (56) allemands, ou empêcher des liaisons radio entre avions allemands. Je raisonnais avec ce que je savais. Or, à l'école de l'Air on ne m'avait jamais parlé de radars, ni d'électronique, ces mots n’étaient pas encore inventés.
Ce n'est qu'à mon retour en France que j’ai appris qu’il y avait des radars, et que ces bandelettes métallisées étaient des « windows » destinés à éblouir les radars ennemis. Ce qui est extraordinaire c'est que je me suis inspiré de ses windows pour, 35 ans plus tard, faire fonctionner ma doseuse miel Apiélectronic, que j'ai fait breveter et vendu dans le monde entier.
Le mois de janvier a passé assez vite et sans pépins. On sentait la fin de la guerre approcher, mais un jour la catastrophe que tout le monde craignait nous est tombée dessus. Je ne me rappelle plus le jour où c'est arrivé. Je pense que c'était fin janvier ou février.
Notre kommando est parti comme d’habitude, à pied, nais au retour, en sortant du chantier de Woffleben, au lieu de tourner à gauche vers Harzungen, la colonne a tourné à droite, vers Ellrich le maudit !
Je n'ai vu personne pleurer, et pourtant il y avait de quoi.
__________________________________
(55) Allez ! Allez ! Allez !
(56) Gonio : La radiogoniométrie est la détermination de la direction d'arrivée d'une onde électromagnétique
Le sinistre camp d'Ellrich
Le camp était tout près du village. II fallait traverser un passage à niveau et l'entrée du camp était en face. C'était une ancienne usine de plâtre, des baraquements en bois avaient été construits à gauche de l'entrée, et sur la butte centrale trônait le crématoire.
Nous n'avions pas encore vu un crématoire de près ; là nous 1'avions sous les yeux, d'autant plus qu'on a logé notre kommando dans l’ancienne usine au 1er étage, sur la dalle de ciment, sans même le moindre brin de paille pour amortir le contact avec le ciment. Non seulement, il n'y avait pas de portes ni fenêtres, mais le mur de façade était absent, ce qui nous laissait une vue totalement dégagée sur le camp et le four ! Au centre, bien entendu il y avait la place d'appel, comme partout.
Le commandement « extérieur ou officiel » était assuré par un adjudant SS et plusieurs adjoints. Nulle part je n'avais vu de SS aussi enragés. Le commandement interne était assuré par les verts, c'est à dire ceux qui portaient un écusson vert, c'est-à dire aussi qu'il s'agissait de prisonniers de droit commun. On a dit que le « Lagerältester », c'est-à-dire le chef de camp avait tué son père et sa mère. Je n'ai pas vérifié, mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, la vie d'un déporté ne comptait pas plus que la vie d'une mouche.
On se couchait en rangs très serrés, tous dans le même sens, pour essayer d'avoir un peu moins froid. A Harzungen, on avait eu très froid dehors, mais dans le block surtout quand le kommando était passé à 1000, nous avions trop chaud, à intérieur, même quand il faisait - 27° dehors. A Ellrich, nous avions aussi froid dedans que dehors, et il est certain que le froid a été la principale cause de 1’effroyable mortalité du mois de mars.
Au tunnel, par contre, on travaillait de moins en moins. J'avais eu une alerte fin janvier. Avec la poussière des foreuses et la fumée des pelleteuses, nous devions respirer cette mixture huit heures d'affilée quand la relève arrivait à l'heure, mais plus souvent, 12 heures et parfois plus. Mon poumon droit s'est mis à me faire très mal et j'ai pris l’habitude de respirer seulement du côté gauche. Puis cela m'a passé pendant quelques jours, mais quand je suis arrivé à Ellrich, c'est le poumon gauche qui a fait la même chose. Je ne respirais plus que du droit, puis une dizaine de jours ayant passé, cela m'a repris du côté droit. Je n'avais pas d'autre solution. Je forçais pour aspirer, et cela me faisait très mal à chaque aspiration, j'avais l’impression que mes plèvres se déchiraient. On s'habitue à tout dit-on ! Je me suis plus ou moins habitué. Dans le convoi entre le tunnel et le camp et surtout au camp, j'essayais de retrouver quelque copain. J'avais laissé Bigot à Harzungen, où je l'avais porté jusqu'au revier, et cela lui a permis d'échapper à Ellrich. Comme proche copain, je n'avais plus que le jeune saint-claudien de 20 ans, et il allait de plus en plus mal, et mon vieil ami Gras (33ème du Grand Orient). A Ellrich nous ne parlions plus beaucoup, mais rien que le fait de nous sentir côte à côte nous réconfortait un peu. Un jour je lui ai demandé : « C'était pire que ça à Dora, l'hiver dernier ? » il m'a répondu : « Dora à côté d'ici… mais c'était le paradis ! ».
II faut dire que la nourriture à Ellrich n'était pas celle d’Harzungen. On ne mangeait pratiquement plus rien. En principe on avait une boule de pain pour dix et une soupe de rutabagas, mais ce n'était pas régulier. Il y avait de plus en plus de jours sans rien du tout.
Je pense que les cuisiniers d’Ellrich avaient l’habitude de préparer et de distribuer la soupe à heure fixe. Nous étions les seuls à faire les 3 X 8, et quand on arrivait, souvent il n'y avait plus rien. Ou bien ils avaient fait porter la nourriture dans notre block, lequel étant ouvert à tous les vents, la nourriture de notre kommando était volée. Le chef de block et le stubendienst étant des verts, ils se foutaient pas mal de nous voir crever.
Au retour du tunnel, il fallait bien supporter l'appel. Le chef de camp (l'adjudant SS) y assistait toujours et il en profitait pour nous faire de grands discours.
Pour aller au travail ou revenir, théoriquement, il y avait un train. C'était un des trains qui vidaient les cailloux, et les wagons étaient des wagons basculants ; ils n'avaient pas le fond rectangulaire mais arrondi. Quand on montait là-dedans, ceux qui se trouvaient vers le centre, pouvaient se tenir debout, mais ceux qui étaient sur les côtés glissaient, ils se cramponnait aux parois ou se couchaient plus ou moins… c'était parfois pire que de marcher. D'autre part, ce train n’était jamais l'heure, ni pour le départ, ni pour le retour. Au départ souvent on attendait qu'il arrive. Au retour, la colonne attendait généralement pendant une heure, puis on prenait la route et on rentrait à pied. Le chemin était un peu moins long que pour Harzungen.
II fallait porter les morts et il y en avait toujours de plus en plus. Quand on partait du block pour aller au travail, on laissait les morts sur place. Mais quand on revenait, il fallait que le compte y soit. On les alignait côte à côte, dans le même alignement que nous pour qu'ils soient faciles à compter. Généralement ils étaient nus car depuis longtemps les SS ne notaient plus les numéros des morts, ils ne comptaient que le nombre. D'ailleurs en février-mars, nous avions presque tous changé de veste et très peu avaient leur vrai numéro. De plus, les morts n'ayant plus besoin de vêtements, ils étaient rapidement déshabillés et certains déportés avaient 2 ou 3 vestes, et autant de pantalons sur eux. Après l'appel il fallait porter les morts jusqu'au crématoire. J'étais pratiquement de corvée tous les jours pour ce sale boulot, toujours parce que j'avais les épaules plus larges que les autres. Et pourtant ces malheureux ne pesaient pas bien lourd. Le règlement prévoyait qu'on devait se mettre à deux pour porter un mort… J'aurais souvent préféré le porter tout seul.
Un jour malheureusement, il m'a fallu porter le cadavre de mon ami saint-claudien. En arrivant sous l’auvent du crématoire nous l’avons jeté sur le tas. Je me suis tourné vers lui, pour lui dire adieu et j'ai eu 1’impression qu'il bougeait encore ; j'ai pris une main, je 1'ai un peu tiré en le secouant, il m’a regardé… il n’était pas mort ! Nous l'avons repris à deux, mais pas de la même façon, il marchait machinalement, mais en réalité on le portait. Notre block n'était pas loin du crématoire, mais il a répété au moins 20 fois : « Eh bien, je reviens de loin ! ». Certes oui, mais cela ne l'a guère avancé. Des copains qui avaient plusieurs vêtements lui en ont cédé un, mais au réveil il était bien mort cette fois.
Comme vrai copain, parmi tous ceux que j'avais suivis depuis le début, il n'y avait plus que Gras.
Au tunnel vers le début mars, je ne sais plus si c'était au tunnel 6, mais comme à cette époque ils étaient tous reliés entre eux par les grandes salles, on ne savait pas toujours où l’on se trouvait.
Les ingénieurs avaient imaginé un truc original, qui aurait dû leur faire gagner du temps… En réalité cela leur en a fait perdre beaucoup. Ils avaient fait creuser en prolongation du tunnel d'entrée, celui qui était étroit, un tunnel tout petit mais sur une longueur de 150 mètres au moins. Ils avaient fait percer des trous de mine dans tous les sens à la verticale, comme sur les côtés, puis ils avaient garni tout cela de dynamite (j'ai compté que cela représentait plus de 60 tonnes de dynamite qui ont explosé en même temps). Avant de faire exploser, ils avaient installé tout le long, une immense chenille comme une chenille de tank. Ils avaient prévu des supports, enfin, tout ce qu'il fallait, pour que lorsque la roche serait brisée, cette chenille puisse ramener la grande majorité des cailloux, jusque au-dessus des wagons qui pouvaient se présenter sans aucun problème. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c'est qu'il se trouverait toujours un déporté pour saboter un point sensible. J’ignore qui c’était, et même de quelle nationalité il était, mais quelqu'un a retiré un axe entre deux maillons de cette chaîne. II a peut-être même remis les écrous en place pour que les derniers contrôles ne découvrent rien. Mais le fait était là : ils ont mis en marche, la chenille est bien venue, mais elle n’est quand même pas repartie.
J'ai été affecté au déblaiement de ce tunnel. Quand j'ai vu le chantier, j'ai dit aux collègues : « Cette fois, nous sommes sûrs que la guerre sera finie avant que ce tunnel soit dégagé ». Comme tout était prêt pour que la chaîne remplisse le wagon, ils ont décidé que nous devions aplanir le haut, et avec des brouettes commencer par le fond, et vider nos brouettes dans le wagon. C'était relativement de niveau et pas tellement pénible pour des gens en forme, mais pour nous qui étions tous à bout de souffle, ce n'était pas si simple. J'ai travaillé là 2 ou 3 jours sans trop forcer. Il n 'y avait plus de meister pour nous surveiller. J'aurais tenu le coup. Mais j'avais pris tellement l'habitude de saboter chaque fois que l'occasion s'en présentait, que je n’ai pas pu résister. En repartant avec ma brouette vide, j'ai vu le câble électrique qui amenait le courant jusqu'au fond de ce tunnel. J'ai vu une pioche, il y en avait partout. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. J'ai donné un violent coup de pioche sur le fil... et la lumière ne fut plus !
C'était idiot, parce que cela ne servait à rien, mis à part un petit temps de repos, pour moi et mes camarades. J'avais avancé un peu plus loin avec ma brouette, et j'avais dormi un peu sur les galets. Quand la lumière est revenue, il y a eu un branle-bas de combat. Ils ont rassemblé tout le monde, il y avait une dizaine de SS, des ingénieurs et des meisters rassemblés près du wagon. L'un des meisters m'a désigné en affirmant que c'était moi qui avais coupé le câble. II ne pouvait pas m'avoir vu. J'étais sûr qu'il n'y avait personne. Comment pouvait-il affirmer que c'était moi ? Je ne le saurai jamais. Je commençais à regretter ce coup de pioche ! Naturellement je prenais un air innocent, et je faisais semblant de ne rien comprendre, je demandais même un « dolmetscher » (interprète). J'entrevoyais la corde autour de mon cou, je n'en menais pas large, mais je me gardais bien de le laisser paraître. Cette discussion m'a paru interminable, mais tout d’un coup j'ai aperçu le « bon meister », celui à qui j'avais appris à forer. J'ai dû lui lancer un regard qui en disait long, il a compris de suite, et il s'est mêlé à la discussion. II avait pris beaucoup d'assurance depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Il a dû demander aux autres ce qui se passait, et tout d'un coup mais avec force gestes, pour que je comprenne bien il leur a dit : « Mais ce n'est pas possible, je l'avais pris avec moi, pour porter à l'atelier une perforatrice en panne pour la faire réparer ». Je n'avais pas perdu un seul mot de ce qu'il avait dit rien qu'en suivant ses gestes. Et ces imbéciles de SS m'ont demandé à moi… si c'était vrai ? « Ya, Ya ! » Je me disais que peut-être j'avais répondu un peu vite, ils auraient pu trouver louche cette réponse aussi rapide de la part de quelqu'un qui prétendait ne pas comprendre un mot d'allemand une minute avant. Mais non, cette idée ne leur est pas venue. Je poussais un ouf de soulagement, mais je le gardais intérieurement. Je n'ai pas adressé un regard de remerciement à mon sauveur mais je savais bien qu'il préférait ça, car lui aussi avait risqué gros. Je n'ai jamais revu ce « bon meister », mais je me suis promis cent fois que, si je le revoyais un jour, je lui payerais un sacré gueuleton !
Un jour où nous devions être d'équipe du matin, quand nous sommes rentrés au camp, il faisait bien jour. Comme d'habitude, nous sommes allés sur la place pour nous faire compter. II y avait déjà le SS chef du camp, le lagerältester, et un tas de kapos, et Cie. Et il y avait aussi un pauvre diable de russe, qui était de notre kommando. Ils nous ont comptés et recomptés comme d'habitude, puis le chef SS nous a fait un grand discours, disant que le russe qui était devant nous avait été surpris en train de découper un «steack» dans un cadavre ! Cela ne nous faisait pas rire du tout, les SS et les verts riaient très fort. Je me suis demandé s’ils n'allaient pas se mettre à nous taper dessus pour nous faire rire. Comme j'étais au premier rang, j'étais inquiet. Puis il a sorti un couteau de sa poche, il a tranquillement sorti la lame, il s'est dirigé vers les cadavres alignés, il a écarté les jambes d'un mort et il a coupé les testicules, puis il est revenu vers le russe en lui présentant les testicules et en disant : « Tiens, mange ça, c'est un morceau de choix ! ». Les autres SS riaient, les « verts » se tapaient sur les cuisses. Dans nos rangs, même les « primitifs » n'avaient aucune envie de rire. On m'a dit que des scènes semblables s'étaient déjà déroulées à Ellrich, que ce n'était pas la première fois.
Enfin quand ils ont eu bien ri, le SS a fait signe à 2 stubendienst qui se sont mis en devoir de taper sur le pauvre russe pour lui faire avaler le morceau de choix… Quand il a eu fini, le SS a fait un autre signe, et les autres ont tapé plus fort sur la tête jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Le lendemain ou le surlendemain, au tunnel, j'étais en train de remplir ma brouette sans me presser, j'avais la jambe gauche en avant, une pierre est tombée de la voûte sur mon pied gauche. Cette pierre n'était pas énorme, mais elle devait bien peser quand même une trentaine de kilos. Mon gros orteil était complètement écrabouillé, il y avait même des esquilles d'os qui sortaient. L'orteil suivant était cassé mais ne saignait pas. Les autres orteils n'avaient rien. Cela me faisait très mal bien sûr, mais je me disais, cette fois quand même, ils seront bien obligés de m’accepter au « revier » (hôpital).
Dans les tunnels les chutes de pierres étaient monnaie courante, surtout au moment où des mines explosaient dans les tunnels voisins. Un certain nombre de meisters y avaient perdu la vie, mais évidemment, un très grand nombre de déportés aussi.
En arrivant au camp, je me suis présenté au revier. Un prétendu chirurgien est allé chercher un sécateur et j'ai compris qu'il allait me couper le gros orteil pour me renvoyer au travail. Comme je n'étais pas spécialement d'accord, j'ai fait un crochet et je me suis présenté un peu plus loin. L'autre prétendu médecin m'a envoyé dans une petite colonne en formation. II faut dire qu'à Ellrich, il n'y avait aucun vrai médecin, et je le savais.
Notre groupe est entré dans une baraque, je n’ai jamais su si c'était le revier, ou une infirmerie, ou un block schonung (57)! On nous a fait déshabiller dans le couloir (les vêtements étaient pour ceux qui travaillaient). Les malades n'avaient pas besoin de vêtements. On nous a fait prendre une douche, chaude S V P, cela ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps, et je croyais avoir trouvé le filon.
Puis on m'a fait entrer dans la pièce attenante. Là, malgré mon ventre vide, j'ai eu envie de vomir. C'était une baraque comme à Harzungen : un rang de lits tout autour, et au milieu deux rangs dos à dos. Naturellement c'était des lits à trois étages et ils se touchaient, exactement comme Harzungen. Chaque étage était occupé par 2 ou 3 malades. Mais les couloirs aussi étaient occupés… par des cadavres, des tas de cadavres. On m'a dit que d'habitude ils les ramassaient 2 fois par jour mais quand je suis arrivé il n'y avait pas eu de ramassage le matin. Il était très difficile de circuler sans marcher dessus. Enfin, une demi-heure après mon arrivée, des « spécialistes » sont venus les ramasser.
Pour chercher une place, j'ai d'abord demandé, comme toujours : « Y a -t-il des français par-là ? ». Les premiers qui m'ont répondu étaient déjà trois à leur étage. Je suis allé plus loin et j'en ai trouvé un qui était seul mais il était couvert de pus... J'ai poursuivi et j'avais presque fait le tour, j'ai trouvé un lit où justement à l'étage du milieu, le plus commode, il y avait deux pauvres diables mais pas de pus apparent. Je leur ai dit que j'avais fait le tour, et que je ne pouvais pas me mettre ailleurs. Il y avait bien un français tout seul, mais avec tellement de pus que j 'avais des raisons avec mes blessures … enfin ils ne pouvaient pas refuser, et puis moi ou un autre… Ils m'ont quand même dit : « Tu sais, du pus, y en a partout. Enfonce un peu ton doigt dans la paillasse et regarde ! ». En effet, quand on appuyait un peu fort, le pus ressortait du matelas. Ils m'ont dit : « Rassures-toi, les autres matelas sont pires ». Et moi qui croyais être entré dans un hôpital !
J’ai déjà dit que mes poumons me faisaient très mal, et j'évitais de parler. Dans cette baraque il faisait très chaud, j'en avais perdu l'habitude, mais cette chaleur, malgré notre nudité, me faisait du bien, et je parlais plus facilement. J'ai immédiatement vu que mes 2 copains étaient juifs (par force) et comme il y en avait très peu parmi nous, je leur ai demandé par quels camps ils étaient passés. Ils m'ont répondu qu'ils été restés un temps à Auschwitz et qu'ils avaient été mutés à Ellrich, l’expansion d’Auschwitz. Des autres camps on parlait parfois d'Auschwitz et il avait mauvaise réputation. Je leur ai demandé comment cela se passait, et leur avis par rapport à Ellrich. Ils m'ont répondu, avec un ensemble parfait qu'Auschwitz était un paradis par rapport à Ellrich. Ils m’ont expliqué que là-bas les SS faisaient passer à la chambre à gaz les gens qui ne pouvaient pas, ou plus, travailler, mais que ceux qui pouvaient travailler étaient affectés à des kommandos pour travailler, comme dans tous les camps. Ils m'ont dit : « Tu parles, il aurait bien mieux valu passer à la chambre à gaz. Ça fait des mois qu'on travaille sous la schlague, avec une nourriture qui n'en est pas une, maintenant on est dans cette baraque au milieu des cadavres, on est là pour y crever, et on n'a même pas les moyens de se suicider. Ceux qui sont passés à la chambre à gaz en arrivant, ont eu de la chance ». Ce sont deux juifs qui m’ont dit ça … Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen !
Ces deux juifs étaient bien gentils, et je voyais bien qu'ils ne se faisaient plus d'illusions, mais ils étaient à bout et attendaient la mort. Moi, je ne voulais pas crever là-dedans. Naturellement j'avais demandé quand on pouvait espérer avoir une distribution de soupe. Ils m'avaient dit qu'il y en avait eu une quelques jours avant, et qu'en principe il y en avait une tous les 2 ou 3 jours. J'espérais qu'il y en aurait une le lendemain. Au lieu de soupe, on a reçu la visite d'un « infirmier ». Il était équipé d'une serpillière et d’une bassine d'eau évidemment très sale, et il voulait faire une compresse à tous, là où ils avaient mal. II était très consciencieux, il voulait faire ça à tous… y compris sur mon pied. J'ai été obligé de jouer à cache-cache avec lui pour éviter ses soins. J'ai compris que si je restais un jour de plus, je n'aurais plus le courage de réagir. J'ai décidé de filer, mais j'ai attendu le lendemain, pour passer une nuit au chaud. Des anciens de ce lieu m'ont dit que la dernière distribution de soupe avait eu lieu un matin de bonne heure, et que ça faisait le 4ème jour sans rien, qu'on aurait sûrement une distribution le lendemain matin. J’ai attendu jusque vers 10 heures, rien n’est arrivé, alors je suis tranquillement passé par la fenêtre, après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun gradé dans les environs. J'étais à poil, et il me fallait trouver un mort pour prendre ses vêtements. Des morts, il y en avait un tas à côté de la baraque, mais ils étaient nus. J'ai dû trainer un moment pour en trouver un habillé. Enfin je l'ai trouvé, et j’ai pris ses fringues. Je suis allé à mon block. Manque de pot la soupe avait été distribuée une heure plus tôt que d'habitude, et il n'y avait plus rien pour moi. J'ai retrouvé mon ami Gras, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Je lui ai expliqué ce qui se passait au revier. Il m'a dit qu'il s’en doutait. Je lui ai dit aussi que je n'en pouvais plus, et qu'avec mon pied écrasé, s'il fallait marcher, je ne tiendrais peut-être pas le coup ! J’espérais que dans ce cas, il pourrait peut-être m'aider. Il m'a répondu que lui-même était complètement à bout et qu'il était « foutu ». J'ai essayé de le réconforter mais je voyais qu'il ne m'entendait même plus. Nous sommes allés ensemble au tunnel, il y a eu le train.
Nous nous sommes couchés, il était dans mon dos, serré contre moi. Dans la nuit, j'ai senti le froid dans mon dos, j'ai tâté mon ami Gras, 33ème l’égal de Chautemps, l'increvable, celui qui remontait le moral de tous et qui se disait si sûr de rentrer en France… Hélas, il ne rentrerait pas, il était mort, sur cette dalle de l'usine à plâtre d’Ellrich, le camp maudit. Et moi, je n'avais plus un seul vrai copain.
________________________
(57) Block des convalescents
Ellrich ! la fin et la faim
La mort de mon ami Gras m'avait quand même surpris. Je le considérais comme un surhomme, et puis... je n'avais plus d'ami.
La veille nous étions bien allés ensemble au travail, mais nous n'avions pas travaillé. Les SS avaient fini par comprendre que leur guerre ne serait pas victorieuse et ils nous laissaient à peu près tranquilles. Malgré mon pied en marmelade, je m'étais un peu traîné sur le chantier, pour voir si je n’apercevais pas le bon meister ou l’ingénieur qui m'avait souvent donné des cigarettes. On était de l'équipe d’après-midi, et la chance m'a souri. J'ai aperçu l'ingénieur en question. Je me suis arrangé pour passer à proximité, et lui ne s'est pas tellement caché pour venir vers moi et pour me donner ce qui restait dans son paquet de cigarettes. II y avait 5 ou 6 cigarettes. C'est tout ce qui lui restait. Il ne m'avait jamais adressé la parole depuis notre première rencontre, mais ce jour-là, il m'a parlé à nouveau. II m'a dit qu'il fallait tenir bon, et que la guerre serait bientôt finie. Je le savais, mais j’étais quand même heureux de le lui entendre dire. Il m'a demandé si je fumais avant mon arrestation. Je lui ai répondu que non, et que je n'avais jamais fumé une seule des cigarettes qu'il m'avait données, mais que, si au début je les donnais à des amis, depuis un certain temps elles me permettaient d'avoir de temps en temps un peu de soupe ou de pain, et que ses cigarettes m'avaient peut-être sauvé la vie jusque-là.
Je ne peux le certifier, mais je crois bien que Gras est mort dans la nuit du 30 ou 31 mars, Or le 1er avril, nous sommes montés dans le train qui devait nous mener à Woffleben, mais le train n'est pas parti. Nous avons attendu environ 2 heures et nos gardiens nous ont fait descendre. Nous n'allions plus travailler ! Bien entendu, il y a eu le sacrosaint appel. Il a été aussi long que d'habitude mais cette fois, il n'y avait pas de morts, ou très peu. Pendant cet appel, des avions de chasse, une patrouille de trois, nous ont survolés, à basse altitude (500 mètres environ). Les SS sont allés dans leur abri ! Moi, j'étais aux anges, il n'y avait plus que quelques belges autour de moi, mais j'ai dû me faire comprendre aussi par quelques « primitifs » … Je leur ai dit : « Cette fois les gars, ce sont des chasseurs ». Les autres disaient : « Tu parles, des avions américains, depuis le temps qu'on en voit ! ». Et je leur disais : « Oui, mais cette fois ce sont des chasseurs, et les chasseurs ne vont jamais loin en territoire ennemi, je sais ce que je dis, je suis pilote de chasse. Si ces 3 avions, sont venus jusque-là, c'est que les troupes au sol sont tout près ». On entendait le canon depuis plusieurs jours, et il se rapprochait un peu chaque jour. Nous ne sommes pas retournés au chantier, nous attendions la fin. Mais à Ellrich ceux qui ne travaillaient pas ne mangeaient pas (et ceux qui travaillaient ne mangeaient guère). Je ne sentais plus tellement la faim, on s'habitue à tout. Seulement, je me rappelais l’histoire d'un certain âne que son propriétaire avait habitué à ne plus rien manger, et qui était mort juste au moment où il s’était habitué.
Quelqu'un m'avait dit, je crois que c'était l'un des juifs dont j'avais partagé la paillasse, au revier, que dans une baraque où logeaient les « petits verts » c'est à dire des détenus de droit commun qui ne portaient pas de brassard, des sans-grades, qui faisaient les corvées intérieures (nettoyage, ramassage des cadavres, service du crématoire, etc.), on échangeait des petits morceaux de viande contre une cigarette. Les « vendeurs » prétendaient travailler aux cuisines. Et ils assuraient que cette viande venait des cuisines.
Songeant à l'âne dont je viens de parler, ce n'était pas la première fois que je faisais l’âne. Je suis allé rôder près du block qu'on m'avait indiqué. J'ai montré une cigarette que je cachais dans ma main. Un type est venu vers moi, avec dans la main quelque chose caché dans du papier de sac de ciment. Il l'a ouvert, il y avait un petit steack, 70 grammes environ. Nous avons fait 1'échange. Cette viande était cuite à l'eau, je ne lui ai trouvé aucun goût mais j'ai senti qu'elle me faisait du bien. Le lendemain et le surlendemain, j'y suis retourné, autant de fois que j'avais de cigarettes. Je n'en suis pas fier, mais je suis encore vivant.
Comme on ne travaillait plus, j'ai cherché à retrouver quelque copain. II y avait encore quelques belges, mais plus un seul français à notre équipe. Parmi ceux du début, lorsque le kommando n’était que de 350 hommes, certains avaient eu la chance de rester à Harzungen ; Vincent, bien sûr, et aussi Bigot que j'avais porté au revier, Coquelle bien mal en point, les 2 frères belges qui colportaient toujours de fausses nouvelles, pour soi-disant remonter le moral ; Je m'étais fâché avec eux pour ça. Mais les autres, tous les autres étaient morts à Ellrich, ou sur le chantier de Woffleben. A l'appel, notre colonne qui tenait toute la largeur de la cour d'appel au début, n'en tenait plus qu'une toute petite partie. Chez les russes, j'ai cherché mon pote écrivain public et le lieutenant de l’armée Joukov. Ils avaient disparu aussi.
Nous entendions le son du canon qui se rapprochait, mais nos libérateurs tardaient à venir. Nous avions 1'impression qu'il y avait des distributions de nourriture pour certains kommandos. Pour le nôtre, je ne peux l’affirmer d'une façon absolue, mais je ne crois pas avoir reçu plus d'une seule fois la maigre soupe traditionnelle avec un tout petit morceau de pain entre le 31 mars et le 4 avril. II n'y avait vraiment plus rien à manger du moins pour mon kommando, et les autres principaux kommandos car les petits arrivaient peut-être à obtenir… quelques miettes. On se consolait en se disant que cela ne durerait plus longtemps.
Je n'ai jamais pu me rappeler si c'est le 4 ou le 5 avril, on nous a fait monter dans un wagon. C'était une catastrophe. Nous sentions les Alliés, tout près, et ces salopards voulaient nous amener ailleurs. J'ai bien envisagé de m’évader, on aurait sûrement pu, mais j'étais vraiment trop faible. Je n’en pouvais plus !
Le wagon en question était un wagon plat, en bois, avec des ridelles d'une hauteur de 1 mètre 50 environ. J'ai pensé qu'au moins nous ne suffoquerions pas, comme entre Compiègne et Buchenwald. Il y avait deux « posten » de la Luftwaffe pour nous garder, et ils étaient à la même enseigne que nous. Avant le départ, alors que nous n'y comptions plus, il y a eu une distribution de pain, une demi boule c'est-à-dire 1 kg. Nous avons tous, et sans peine mangé ce pain. C'était plus prudent, mais surtout, nous avions tellement faim que chacun a englouti son pain, en un clin d'œil.
Le train a, démarré, et il a commencé à pleuvoir, et cette pluie était encore très froide. Nos pyjamas devenaient un peu plus lourds, une fois de plus on se résignait. J'avais jeté un coup d'œil sur mes camarades de misère, il n'y avait plus aucun français, et 3 belges, tout au plus. Tout le reste, c’était des russes et des polonais. Je me disais que je risquais gros si une bagarre se déclenchait. Moi qui m'étais tant battu contre les « primitifs », je n'étais pas très fier. Apparemment, tout notre kommando tenait dans ce wagon ; une centaine d'hommes environ, nous ne pouvions pas nous asseoir, encore moins nous allonger, bien sûr nous espérions que le voyage ne durerait pas longtemps. Les russes n'ont pas essayé de nous jeter par-dessus bord, c'est ce que j'avais craint la première nuit, mais ils étaient aussi épuisés que nous et ils n'avaient plus de forces. Au matin le train s'est arrêté dans une gare. Des SS ont circulé le long des voies, ils ont dit aux posten de faire jeter les cadavres le long de la voie. Nous l'avons fait, il y en avait seulement 5 ou 6, dont un belge. Je m'attendais à plus. Le train roulait, s'arrêtait, repartait, il allait vers le nord, puis vers l'est, revenait en arrière, remontait vers le nord, ainsi de suite. Tous les matins, il faisait une halte dans la nature... pour qu'on jette les cadavres, et il y en avait de plus en plus. A partir du 3ème jour, la moitié d'entre nous arrivait à s'allonger à tour de rôle. Le 4ème jour on pouvait tous s'allonger. Combien étions-nous encore ? J’aurais pu les compter, mais je n'en avais plus la force. Je songeais seulement que c'était là tout ce qui restait d'un kommando de près de 1 050 hommes trois mois plus tôt. Et je comprenais bien qu'ils cherchaient un moyen... pour liquider ceux qui avaient résisté jusque-là. On a su plus tard qu'ils avaient voulu nous amener à Hambourg, pour nous mettre dans des bateaux qui seraient coulés ! Ils l'ont fait pour certains camarades, mais ils n'ont pas pu nous amener jusqu'au bout parce que les bombardements avaient coupé les voies, et ils sont revenus un peu en arrière.
Le 10 avril, ils nous ont enfin fait descendre de ce train corbillard.
Et il a fallu reprendre la route. Cinq kilomètres à pied. Les posten de la Luftwaffe ont disparu (ils étaient aussi trempés que nous) ; c'était de vrais SS qui les ont remplacés. Je marchais comme un automate. De temps en temps on entendait un coup de pistolet à l'arrière, on savait que c'était un déporté qui ne pouvait plus marcher et qui ne marcherait plus jamais. Les 5 kilomètres m’ont paru trente.
Bergen-Belsen
Enfin nous sommes rentrés dans un camp, mais un camp bizarre comme nous n’en avions jamais vu ; c'était une caserne de SS. Nous avons appris que nous étions au camp de Bergen-Belsen, pas dans le camp des déportés, mais dans celui des SS qui étaient chargés de les garder. Les SS étaient partis ! Pendant le voyage à pied, au moment du regroupement à la gare ou à l'entrée dans le camp, j'avais cherché à me regrouper avec des français. J'en avais trouvé 7 ou 8. Nous sommes montés au premier étage et pris possession d'une chambrée qui devait être prévue pour six hommes. Naturellement il n'y avait plus de lits, mais il y avait par terre un grand nombre de bouteilles vides, des bouteilles d'apéritifs français, surtout du St-Raphaël, Dubonnet, etc. Il y avait des lavabos à l'étage qui coulaient ! J'ai bu et je suis revenu à la chambrée où des copains s'étaient déjà allongés sur le ciment, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Malgré mon extrême fatigue, je les ai secoués en leur disant qu'il fallait absolument remplir le plus possible de ces bouteilles vides pour avoir de l'eau à boire, que les lavabos seraient bientôt fermés. Pas besoin d'être prophète pour deviner cela. Ils l'ont fait avec moi, Heureusement pour nous !
Nous avons enfin pu dormir. Mes voisins se plaignaient de la dureté du ciment. Je leur ai dit que depuis mon arrivée à Ellrich, j'avais couché sur la dalle ouverte à tous les vents de l'usine à plâtre. Eux, étaient dans des kommandos beaucoup moins durs, ils avaient les fameux lits à 9. Ils avaient aussi eu à manger quelques gamelles de soupe entre le 1er et le 4 avril. Ils s'apercevaient qu'il y avait eu plus malheureux qu'eux. Je leur ai montré mon pied écrasé, et ils s’étonnaient beaucoup que j’aie pu tenir le coup jusque-là. Ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont pris en amitié. Je suis sûr que s'il y avait eu une distribution de pain, ils m'auraient laissé le plus gros morceau, mais il n'y a eu aucune distribution ni de pain, ni de soupe, rien du tout. Les jours passaient, heureusement nous avions les bouteilles d'eau, car au lavabo, elle avait cessé de couler une demi-heure après notre arrivée. Nous écoutions le canon. Il ne se rapprochait que très lentement.
Le 24 en fin d'après-midi les SS qui restaient ont eu une idée saugrenue : ils ont décidé de faire un appel. Rassemblement, etc. J'ai eu du mal à m'y rendre. Comme je ne m'alignais pas assez vite, j’ai pris un coup sur la tête, et je suis tombé. J'ai appris plus tard que j'avais été compté avec les morts. Après l’appel, mes nouveaux copains m'avaient récupéré et monté dans la chambre. Ils m'avaient aspergé d'un peu d'eau et je m'étais réveillé. Je les en remercie encore mais je ne me rappelle pas leurs noms. Le lendemain matin, j'ai entendu les mitrailleuses, je leur ai dit : « Cette fois, c'est pour aujourd'hui ! ». Quelques heures après on a vu un tank défoncer la palissade et entrer dans notre camp. Enfin libres ! je n'avais plus la force de parler.
Le lendemain j'ai ouvert les yeux, j'avais changé de chambre, j'étais dans un lit à étages, mais j'étais seul à mon étage. J'ai demandé ce qui s'était passé, et on m’a dit que j'étais à l'infirmerie. Les anglais, sitôt nous avoir libérés, avaient installé une infirmerie. Mes copains avaient dû m'y porter, je n'en avais aucun souvenir. On avait dû me donner quelque chose à manger car je me sentais mieux. Je me rappelle qu'une équipe est passée avec un petit compresseur d'air et ils nous envoyaient une poudre grise dans le pantalon, les manches et partout. Une heure après nous nous sentions beaucoup mieux, les poux qui nous suçaient depuis des mois étaient tués !
Je ne sais pas combien de temps je suis resté à cette infirmerie. Mais j'ai gardé un souvenir que je ne pourrai jamais oublier. On m'avait donné à manger une petite boite de 3 sardines. Je les avais mangées, et je ramassais avec mon ongle le peu d'huile qui restait dans les angles, lorsqu'un officier français, lieutenant d'infanterie (sans doute officier de liaison avec les anglais) est passé dans 1'infirmerie. En arrivant à ma hauteur, l’infirmier lui a dit : « Celui-là, il parait que c'est un officier français ». Le lieutenant a répondu : « Non ce n'est pas possible, un officier français ne ferait pas ça ! ». Je n’ai rien répondu, d'abord parce que j'avais du mal à parler, et puis, à quoi bon ! Mais en moi-même je me disais : « Mon salaud, si tu venais de passer par où je suis passé, tu la ramasserais l'huile qui reste au fond de la boite ». Je n'ai pas dû rester longtemps à cette infirmerie. Dès que j'ai mangé j’ai repris des forces. Contrairement à la plupart de mes camarades, je n'avais pas de dysenterie, je n'en avais pas eu jusque-là. Il y avait des déportés plus malades que moi. On regroupait les français dans un autre block. J'y suis allé et j'ai eu le grand plaisir de retrouver mon ami Jacquin que j'avais connu à la prison du 92 à Clermont-Ferrand. Je l'ai reconnu à la voix, car il était si maigre que je n'aurais pu le reconnaître. J'avais eu peur pour lui car les jeunes de moins de 25 ans n’avaient pas tenu le coup en général. Il était aussi à Dora mais pas dans les tunnels, il était là, vivant, et cela m'a fait un énorme plaisir. La direction des français qui était là, par force - il fallait bien organiser un peu - m'a demandé si je pouvais surveiller la distribution de la nourriture. J'ai fait remarquer que je ne tenais pas debout, mais que s'il le fallait je ferais de mon mieux.
La première nourriture qui a été distribuée pendant que j'étais à ce poste, c'était des boites de saindoux ! Ce n'était pas indiqué, bien sûr, mais les anglais nous ont donné ce qu’ils trouvaient. Je donnais une boite pour 6 ou pour 10, je ne me rappelle plus. A la fin de la distribution, il est resté une dizaine de boites. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais je suis resté avec une boite entière. Et je me suis mis en devoir de manger un peu. Une cuillerée, puis une autre. Je me disais bien que cela allait me rendre malade, mais j'avais tellement faim que je trouvais ce saindoux délicieux. Petit à petit, j'ai mangé toute la boite. Jusque-là je n'avais pas eu de diarrhée, mais là j'ai appris ce que c'était.
Des cadavres et milliers de cadavres
Je l'ai souvent dit à ma famille et à des amis : Si nous avions été libérés un jour plus tard, je ne serais plus là pour écrire ces souvenirs. J'étais vraiment au bout du rouleau par manque de nourriture. Je n'aurais sûrement pas tenu 24 heures de plus.
Les derniers jours, il est mort des quantités incroyables de déportés, qui avaient entendu le canon de nos libérateurs, mais qui n'avaient pas tenu jusqu'au 15. Dans le camp principal on a dit que c'était bien pire et qu'on a poussé les cadavres au bulldozer jusqu'aux fosses communes. Dans le camp où j'étais, dit des SS, il y en avait partout, et je ne crois pas que quelqu'un les ait comptés. II y avait des civils allemands qui traînaient par-là. C'était peut-être des anciens de la Luftwaffe ou des civils réquisitionnés. On les a obligés à creuser des fosses communes. Il y en avait une devant le bâtiment où je me trouvais. Elle faisait environ 50 mètres de long sur 3 ou 4 mètres de large et autant de profondeur. Quand la fosse a été creusée, on a obligé ces allemands à ramasser les morts et les jeter dans la fosse. Je regardais la scène tristement depuis le 1er étage. II y avait entre autres, deux allemands qui avaient pas mal de ventre. J'ai oublié de dire que les déportés avaient obligé ces allemands à se mettre à poil ! On nous 1'avait fait si souvent et par des températures autrement plus basses. Je trouvais cela tout à fait normal. Mais je n'aurais pas eu la force d'aller les frapper pour les obliger à courir. Or il y avait des déportés, je ne sais de quelle nationalité, qui avaient retrouvé assez de forces, ils avaient cherché des bâtons ou schlagues quelconques, et ils frappaient, à leur tour, les allemands qui ramassaient les morts. Personnellement, j'estimais que si ces gars-là avaient été des SS il aurait fallu frapper plus fort. Peut-être aurais-je trouvé assez de force pour aller les frapper moi aussi. Mais rien qu'à les voir on voyait bien que ce n'était pas des SS, alors je trouvais normal de les avoir mis à poil, mais pas normal de les frapper. Et ils transportaient les morts, la fosse se remplissait, mais il a fallu deux jours pour achever le travail.
En regardant courir les deux allemands au gros ventre - cela fait un drôle d'effet de voir un gros ventre ballotter au rythme de la course - je songeais à tous ceux, allemands ou autres qui m'avaient si souvent frappé. Je me disais que l'organisation SS avait bien fait les choses, pour faire de nous des bêtes sauvages. Finalement les vrais SS m'avaient rarement frappé. C'était toujours des intermédiaires qui se chargeaient de ce travail. Certains frappaient contraints et plus ou moins forcés, mais il y en avait tant d'autres qui avaient pris goût à frapper les autres, pourtant déportés comme eux, et je pensais surtout aux tziganes du camp d'Harzungen, qui m’avaient matraqué tant et tant de fois pour le plaisir de frapper un officier. Je pensais aussi aux gosses de Woffleben : le dimanche ou chaque fois qu’ils n’étaient pas à l'école au moment où notre colonne traversait le village, ils rassemblaient des cailloux, avant notre passage, et ils nous les jetaient en nous injuriant. C'était des gosses, bien sûr, mais tout de même, il y avait bien des parents qui voyaient cela et aucun allemand n'avait protesté. On leur avait certainement dit que nous étions là pour y crever. Les gosses pouvaient bien s'amuser un peu. Alors si des déportés obligeaient à courir quelques civils allemands pour porter au plus vite les cadavres de nos malheureux camarades jusqu'à la fosse commune, c'était bien leur tour !
Je suis allé aux toilettes, et j'étais obligé d'y aller souvent, mais une fois j'ai trouvé devant un homme cabossé de tous côtés, et saignant un peu partout.
Il avait dû être laissé là pour mort, et il venait de se réveiller, mais il n'avait pas la force de se relever. Il portait une veste de pyjama qui avait la trace d'un brassard. Il avait enlevé le brassard, mais on voyait bien que cette veste avait porté un brassard et pendant longtemps. Mais ce qui m'a frappé instantanément, c'est qu'il était gros et gras. II m'a supplié de lui donner de l’eau, en français mais avec un fort accent flamand. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai donné un violent coup de claquette en pleine figure, en lui disant : « Salaud, s'ils t'ont fait ça, ils savaient bien pourquoi ! » En revenant vers mes copains, je me disais : « Quand même, je suis devenu un salaud moi aussi ; j’ai frappé ce type alors qu'il ne m'a jamais rien fait. Je ne l'avais jamais vu ». Oui, en l'espace d'un éclair, j'avais revu le stubendienst tzigane de mon block à Harzunqen, celui qui m'avait frappé si souvent, celui qui faisait exprès de vider la louche de soupe à côté de la boite de conserve que je tendais. Le flamand était gros et gras, comme le tzigane qui m'en avait tant fait baver ! Et cela avait suffi pour déclencher ce réflexe de haine. Des collègues l'avaient déjà mis bien mal en point, et je suppose qu'ils avaient d'autres bonnes raisons.
Je n'ai pas assisté à d'autres règlements de comptes, mais il y en a eu beaucoup. Le jugement était vite prononcé, et il y avait encore assez de déportés valides pour appliquer la sentence jusqu'au bout. Des individus gras allaient rejoindre dans la fosse commune ceux qui n'avaient plus que la peau et les os. Je pensais à l’un des grands chefs communistes de Buchenwald. Fin mai 44, il faisait chaud, et il se tenait torse nu à la sortie de la carrière, où il veillait à ce que chacun de nous emporte une pierre assez grosse. II était tellement gras que lorsqu'il était assis, son ventre avançait jusqu'à la hauteur de ses genoux. A Buchenwald, les chefs se portaient bien, je ne savais pas encore que Marcel Paul avait beaucoup grossi, mais je le sentais et je me disais qu'il était bien dommage que Buchenwald n'ait pas été replié sur Bergen-Belsen. S'il y avait eu un petit règlement de comptes sur Marcel Paul, j'aurais retrouvé quelques forces pour aller lui taper dessus...
J'avais la chance de me trouver dans le camp dit des SS. C'était, je l'ai déjà dit, une caserne abandonnée par les SS, mais il y avait des lavabos et des toilettes. L'eau avait été rétablie dès l’arrivée des anglais et cela a dû sauver la vie de nombreux déportés. Mais dans le camp principal (qui était à côté, mais que je n'ai pas visité) il n'y avait parait-il ni lavabos, ni W C, seulement des « tranchées ».
Je ne sais pas combien nous étions dans ce petit camp, peut-être 4 ou 5 000 mais dans le camp principal, il y avait, d'après une statistique SS retrouvée après, 45 117 détenus, dont 14 720 hommes et 30 397 femmes au 31 mars. II n'y a pas eu de relevé officiel après cette date. Les chiffres officiels indiquaient 1 000 morts par jour. Des déportés continuaient d’arriver au début avril. Combien y a-t-il eu de morts entre le 31 mars et le 15 avril ? C'est pendant cette période qu'il y en a eu le plus ! Je n'ai pu trouver nulle part le chiffre des rapatriés de Bergen-Belsen, pourtant quelqu'un doit bien l'avoir. Mais pour le chiffre des morts personne ne le saura jamais. Au camp principal les cadavres ont été poussés au bulldozer dans les fosses communes. Combien y en avait-il ? Je dis plus de 20 000, peut-être plus de 30 000. Quand nous sommes rentrés en France, on ne parlait que de Buchenwald parce que les détenus de ce camp étaient rentrés presque tous, Marcel Paul en tête, et il avait grossi en déportation. Il a été nommé ministre sans même prendre de vacances... il en avait pris à Buchenwald ! Quand on me parlait des camps en présentant Buchenwald comme « terrible » cela me mettait dans une colère noire. J'avais vu cent fois pire, mais comment le faire comprendre ?
Ma diarrhée me posait des problèmes, et c'était bien ma faute, je ne pouvais même pas manger ce qu'on nous donnait, mais je mangeais un peu et je reprenais des forces. Mon pied écrasé allait un peu mieux. La plaie s'était à peu près refermée, les os du gros orteil s'étaient ressoudés entre eux, l'orteil était rigide (il l'est toujours) mais cela ne me gênait presque plus. Je me demandais quand on prendrait la direction de 1'ouest. Je veillais à me trouver toujours parmi les transportables.
Retour en France
Je crois que c'est le 24 avril, on a demandé quels étaient ceux qui pouvaient voyager en camion. J'ai fait vite pour me présenter. Un vague toubib ne voulait pas me laisser monter. II prétendait que je risquais de ne pas tenir le coup. Finalement je suis monté dans le dernier camion. Et nous voilà partis ; enfin, nous avions le sourire. Nous avions quelques provisions et de plus les chauffeurs s'arrêtaient souvent, d'abord pour satisfaire des besoins naturels ; presque tout le monde avait la diarrhée. Notre camion s'étant arrêté près d'un tas de cailloux, les copains ont fait le plein de cailloux. En roulant on croisait forcément des civils allemands et les copains les arrosaient de cailloux, comme les gosses de Woffleben nous l’avaient fait. Personnellement, je n'approuvais pas, mais je laissais faire, en m'amusant un peu. Je n'avais pas la force d'en jeter moi-même, mais je crois que même si j'avais eu la force, je n'en aurais pas jeté. Le chauffeur anglais et les rares responsables anglais qui nous accompagnaient se sont d'abord étonnés, puis l’un d’eux nous a dit : « Si je n'avais pas vu la situation à Bergen-Belsen, je n'aurais jamais toléré ça, mais ayant vu tous ces cadavres, et dans cet état, vous pouvez vous venger comme vous voulez, je laisse faire ».
Nous nous sommes aussi arrêtés devant des fermes. Je n'avais pas assez de forces pour y aller. Des camarades ramenaient des victuailles. Je n'en ai vu aucun frapper ces allemands. Beaucoup criaient : «Polizei, politzei ! ». Alors des camarades les mettaient parfois à poil, en leur disant que maintenant les policiers avaient changé de camp, et que nous on nous avait mis à poil des centaines de fois.
Mes fesses étaient tellement maigres que j'avais l’impression que la pointe de mes os allait percer la peau de mes fesses. Je me tenais de travers, tantôt sur le côté droit, et tantôt sur le gauche. Je trouvais le temps long.
Enfin nous sommes arrivés sur un aérodrome, c'était Rheine. On a embarqué sur des « dakota ». II y avait des copains qui se faisaient tirer l’oreille pour monter en avion. Il faut bien dire qu'à cette époque, prendre l'avion n'était pas encore entré dans les mœurs. J'ai dit que j'étais pilote et que j'étais bien content, que nous n’aurions plus aussi mal aux fesses que dans le camion. C'était bien sûr un avion militaire, prévu pour transporter X militaires avec tout leur barda. II n'y avait que X sièges, et comme nous n'avions aucun barda, et que notre poids moyen était la moitié de celui d'un soldat normal, ils ont fait monter plus de passagers que de sièges et l'avion n'était pas en surcharge. Je n'avais pas de siège, je suis resté assis sur le plancher. Nous pensions rentrer directement en France, mais l'avion s'est posé de nuit à Bruxelles. Les belges nous ont fait un accueil inoubliable. On nous a amenés dans une école pour la nuit. Au réfectoire, nous avons mangé pour la première fois depuis bien longtemps à une vraie table, avec des couverts ! On les touchait, on les caressait avec délice. Des filles nous ont servis ; elles repassaient en disant : « Vous en voulez encore un peu ? ». Beaucoup pleuraient. La transition était tellement brutale que nous n'arrivions pas à y croire. Le lendemain matin on nous a dit que nous ne repartirions que le soir par le train, et pour la France. Nous sommes sortis de cette école pour voir un peu Bruxelles. II y avait là une foule considérable. Tous voulaient nous emmener chez eux. J'ai été pratiquement enlevé, et je me suis retrouvé dans un appartement belge avec des gens extrêmement gentils, mais qui voulaient toutes sortes d'explications. Or mon pied allait mieux, et mes poumons aussi quand même ; ils me faisaient moins mal, mais pour parler je devais reprendre ma respiration, à tous les mots ou presque. Mes hôtes m'ont demandé ce qui me ferait plaisir. J'ai un peu hésité, puis je leur ai dit : « Il y a bien quelque chose qui me ferait énormément plaisir, mais depuis que la guerre dure, vous n'en avez sans doute plus, c'est un coup de rouge ! ». Ils ont ri et le père s'est absenté un moment, il est revenu avec une bouteille de Bordeaux ! J'ai dû en boire 2 ou 3 verres, tout en discutant et en mangeant des gâteaux. Quand je me suis levé, j'étais peut-être un peu pompette, mais j'étais tellement heureux. Mes hôtes le voyaient bien et ils étaient heureux aussi.
Le soir nous avons pris le train, mais cette fois dans des wagons voyageurs. Je ne me souviens pas comment nous avons dormi. Le lendemain matin nous étions à Lille. Nous avons été déçus de l’accueil. Personne ne nous regardait, personne ne souriait. Nous avons revu le drapeau français, et je crois bien que nous avons pleuré en le voyant. Pour comprendre il faut avoir vécu ce que nous avions vécu.
Beaucoup de prisonniers de guerre rentraient en même temps que nous. Nous devions tous passer une visite médicale. Les prisonniers défilaient rapidement. Quand mon tour est arrivé de passer à la radio, j'ai dû rester plus longtemps. Le toubib dictait quelque chose à 1'infirmier. J’ai demandé qu'est-ce qu'il avait dit, et 1'infirmier m'a répondu que je devrais passer quelques mois en sana, mais que je guérirais. La perspective du sana ne m'emballait guère, et je réfléchissais à ce que j'allais faire. J'avais constaté que le peu de Bordeaux que j'avais bu chez les belges avait stoppé ma diarrhée ou presque. Quelques temps avant mon arrestation, j'avais amené ma femme chez mes beaux-parents, réfugiés à Romorantin, et j'avais aussi amené plusieurs seaux pleins de miel. Je pensais qu'ils n'avaient pas dû manger tout ce miel, et que, moi, si j'avais du miel à manger, mes poumons seraient vite guéris.
Nous sommes arrivés en gare du Nord, à Paris, et les gens qui s'occupaient de nous ont formé une petite colonne de ceux qui devaient aller en sana. Nous n'étions pas loin de la bouche de métro. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, j'ai plongé dans le métro et je suis arrivé à la gare d'Austerlitz.
La Croix-Rouge distribuait un colis à tous les rapatriés. Quelqu'un m'a dit que ce colis pesait 5 kg. Je ne sais plus, il ne faisait peut-être que 3 kg. Un train pour Orléans allait partir. Je suis monté dedans, et un voyageur voyant mon état m'a cédé une place dans un angle. Le train a démarré.
J’ai ouvert mon colis. II y avait du saucisson, du chocolat, et je ne sais quoi. Je me suis mis à manger, tranquillement, mais sans arrêt, et quand le train est arrivé aux Aubrais, il ne restait que le papier ou des boites vides. Jusque-là personne n'avait osé m'adresser la parole, tous me regardaient comme une bête curieuse, mais dans le compartiment personne ne parlait. Pendant que je rangeais mes papiers, la femme qui était en face de moi a dit : « Eh bien monsieur, je ne sais pas d'où vous venez, vous avez vraiment mauvaise mine ! mais avec l’appétit que vous avez, je crois que vous vous en sortirez ».
Sur la petite voie qui menait à Romorantin, j'ai rencontré une personne qui habitait Lanthenay ouest, là où devait se trouver ma femme. Je lui ai demandé si elle la connaissait et d'après la description que j’en ai faite, elle m’a dit : « Oui, je l’ai aperçue avec une voiture d'enfant », mais c'est tout ce qu'elle a pu me dire.
Mon fils aîné était né le 1er août 1940. Mon groupe de chasse s'était replié jusqu'à Toulouse, puis nous étions remontés à Clermont-Ferrand (Aulnat) pour assurer la protection de Vichy. Je n'avais aucune nouvelle de ma femme depuis le 5 juin. Le 21 août, j'ai appris par une lettre d’une assistante sociale que j'avais un fils, et qu'ils étaient à Romorantin où mes beaux-parents s'étaient réfugiés. J'ai immédiatement demandé une permission de 3 jours, mais comme il n'était pas question d'aller en zone occupée, j’ai demandé la permission pour l’Aveyron. En réalité, j'avais foncé jusqu'à l'un des points de passage, pas trop loin de Romorantin. J'avais combiné un petit scénario pour aller chercher ma femme et mon fils. Un sous-officier français, dont je ne me rappelle plus le nom, m'a aidé. J'avais ramené ma femme et le petit à Clermont-Ferrand, en cinq jours au lieu de trois, mais lorsque j'ai expliqué au commandant de groupe ce qui m'était arrivé, il m'a excusé !
Mon premier fils avait donc 3 semaines lorsque j'avais été informé de sa naissance. En rentrant à Romorantin, ce 28 avril 1945, je savais bien qu'il devait y en avoir un autre, garçon ou fille, et qu'il devait avoir environ onze mois, mais ce n’est qu'en arrivant là où habitaient provisoirement mes beaux-parents, que j'ai appris que j'avais un 2ème fils.
Depuis Lille, j'avais envoyé un télégramme disant simplement : « J'arrive ». II est inutile de dire combien tous étaient heureux de me revoir, et moi, donc ! Mais le petit Daniel qui avait bien onze mois, ne m'avait jamais vu, il s'est mis à hurler et cela a duré plusieurs jours. Le cadavre ambulant que j'étais, avait beau lui sourire... je devais me cacher de lui pour qu’il cesse de hurler.
A Harzungen, je l’ai déjà dit, il y avait avec moi, Charmaison, fils du maire de Romorantin, et nous avions convenu que le premier de nous deux qui rentrerait à Romo irait donner des nouvelles aux parents de l'autre. J'avais laissé Charmaison à 1'infirmerie de Harzungen, en même temps que Bigot et Coquelle, lorsque nous avions bifurqué sur le sale camp d'Ellrich. Ils étaient tous les 3 en très mauvais état, et je n'espérais guère les revoir. Dès le lendemain de mon arrivée, j'ai dit à ma famille que je devais aller voir le maire de Romo. Ma femme et mon beau-père sont venus avec moi. Il m'a très bien reçu mais d'une manière très décontractée. II m'a dit qu’ils avaient reçu le matin même un télégramme de leur fils, disant qu'il allait en sana. Et nous avons parlé des camps. Je parlais très difficilement, car je devais reprendre ma respiration presque à chaque mot, mais M. Charmaison parlait pour deux. II m'a dit que, en tant que maire, il avait eu l'occasion de parler de Buchenwald avec des allemands, je suppose, et que ce camp était très bien, qu'il y avait des bâtiments superbes, des lavabos splendides, et même une piscine. J'ai réussi à placer quelques mots pour ajouter : « Je n'ai jamais vu la piscine, ce n'est pas impossible, ils ont oublié de vous le dire, il y avait aussi un bordel ! mais puisque votre fils est de retour, il vous expliquera lui-même, ce qu'étaient les camps d'extermination ». Et je suis parti.
Par la suite M. Charmaison a été très gentil avec moi. II avait une chasse gardée près de Romo, il m'y a invité et j'y suis allé plusieurs fois.
Je me suis remis très rapidement. II restait du miel, et tous les matins je prenais non pas un bol de lait et un peu de miel, mais je prenais un plein bol de miel et un verre de lait. Dans la journée je n'arrêtais pas de manger, et à minuit, ma femme devait se lever pour me faire un beefsteak. En un mois et demi, j'ai repris 27 kg. J'avais repris suffisamment de force pour me promener un peu. J'étais allé voir ma famille dans l'Aveyron. J'ai pensé qu'il était temps d'aller au ministère de 1'Air pour voir où en était ma situation militaire.
J'ai remis ma tenue de lieutenant, j'étais lieutenant le plus officiellement du monde depuis 1941. On m'a assez dit après que j’avais fait une grosse bourde, j'aurais dû mettre au moins 4 galons, et dire que j'avais été promu dans la Résistance, puisque j'avais fait fonction de commandant et même plus. Je n'ai jamais été atteint d' « avancite » aiguë. Je me suis pointé au Boulevard Victor en tenue de lieutenant. J'ai demandé le bureau du personnel ; c'était au dernier étage. J'y suis monté, et je me suis présenté : « Lieutenant Bannes Albert, pilote ! » Ils ont cherché un bon moment. J'ai donné des précisions. L’officier qui cherchait a fini par dire : « Ah non, ce n'est pas possible, le lieutenant Bannes a été fusillé par les Allemands à Aulnat en avril 44 ».
Cela fait toujours plaisir d'entendre qu'on a été fusillé, quand on est sûr de penser encore. Il m'a demandé si je connaissais des officiers qui pourraient témoigner que j'étais le lieutenant Bannes. Alors je lui ai demandé les noms des officiers qui se trouvaient dans les bureaux environnants, à commencer par le 1er bureau. II m'a dit que le chef du 1er bureau, était le Colonel Naudy. J'ai dit : « Celui qui commandait le 2/9 ? ». II m'a répondu « oui ». « Où est son bureau ? » Et j'ai foncé au bureau de Naudy. J'ai frappé par habitude et je suis entré. Le Colonel Naudy était en train d'éplucher des papiers, il a jeté un œil sur moi, et m'a dit : « Qu'est-ce que vous voulez ? ». J'étais un peu interloqué. J'avais repris 27 kg et je pensais être redevenu à peu près comme avant, mais Naudy ne me reconnaissait pas ! Je lui ai dit : « Mais, mon Colonel, vous ne me reconnaissez pas ? ». Alors, il m'a regardé, et il a dit : « Si, à la voix ; puis, mais vous êtes encore lieutenant ? ». A quoi, bien sûr, j'ai répondu que là où j'étais on ne risquait pas de me nommer capitaine. Alors, il a appelé un de ses secrétaires et lui a dit : « Faites immédiatement un dossier de nomination pour Bannes au grade de capitaine ». II a ajouté pour moi, dans quelques mois je vous ferai nommer commandant. Malheureusement, pour lui et pour moi, le colonel Naudy s'est tué en avion 3 ou 4 mois plus tard. Quant à moi, j'ai été promu commandant en février 1953.
J'ai donc été repris en compte par 1'Armée de l’Air et je suis allé passer la visite médicale du personnel navigant. Nous étions une quinzaine, comme d'habitude, dans la salle d'attente. Le médecin-chef est arrivé, il a jeté un coup d'œil d'ensemble mais son regard s'est arrêté sur moi, et il m'a dit : « Vous, venez avec moi ! ». Nous sommes entrés dans son bureau, et il m'a demandé : « D'où venez-vous ?». Je lui ai expliqué. II m'a dit : « Et vous venez comme ça, vous croyez que je vais vous autoriser à reprendre un avion ? Allons passer d'abord une radio !». Je suis passé à la radio, et il m'a dit que du côté gauche, ça allait presque, mais que du côté droit, il serait bon que j'aille quelque temps en sana. Voilà que ça recommençait. Je lui ai expliqué qu'à mon retour j’étais très mal en point et que je me guérissais tout seul, Je lui ai montré la radio que m'avait faite le toubib à mon arrivée et il a reconnu que j'avais fait beaucoup de progrès sans le sana ! II m'a demandé si j 'avais un point de chute en demi-montagne. Je lui ai répondu que j'avais un appartement à Saint-Sauves-d'Auvergne, même altitude que La Bourboule, que le boucher du coin était un copain, et qu'il me donnerait autant de viande que je voudrais, que j'avais encore là-bas un stock de miel, etc. J'ai convaincu le médecin-chef du centre d'examen du personnel naviguant que je me guérirais mieux tout seul et en famille que dans un sana. Il m'a mis en convalescence pour six mois, et m'a simplement dit de revenir le voir après.
Avec ma femme et mes deux enfants, nous sommes retournés à Saint-Sauves. L'appartement était resté vacant en notre absence. Toute la population nous a fêtés. Le boucher faisait bien parti de la Résistance mais il n'avait appris qu’après mon arrestation que j’en étais le chef, car pendant que j’étais là pour la Résistance, je ne l'avais dit à personne. Le boucher voulait me faire plaisir et il choisissait les meilleurs morceaux et refusait parfois d'être payé. Je me suis complètement remis, même si mon poumon droit a toujours une tâche noire (il l'a encore 45 ans après).
Des copains de déportation sont venus me voir : Vincent Buiguez, bien sûr, nous nous voyons toujours le plus souvent possible, Albert Bigot, qui avait repris sa place à l'Elysée Palace à Vichy. Mon excellent ami le lieutenant Frety, dit Job, chef radio de 1'ORA, est venu me voir. II n'était plus le même. Il avait été déporté dans d'autres camps que les miens. Nous avons déjeuné gaiement, mais je sentais que quelque chose n'allait pas, à mon avis du moins ! Au moment de repartir, il m'a dit : « Je suis venu te voir pour te dire adieu. Tu as été mon meilleur copain dans la Résistance, je ne t'oublierai pas, mais je me retire, je rentre à La Trappe ». J'en avais les larmes aux yeux. J'avais envie d'essayer de l’en dissuader, mais je savais bien que s’il avait pris cette décision, il avait ses raisons. Je n'ai rien dit, nous nous étions compris. J'ai souvent pensé à lui. Dans cette maison de Saint-Sauves, il y avait une grande pièce où 2 fois à 2 mois d’intervalle nous avions tendu l’antenne qui nous permettait de communiquer avec Londres, et c'était Frety lui-même qui maniait le « tititah » ! (58)
PS : dans de nombreux récits que j’ai lus, des déportés parlent des colis qu’ils recevaient. En 13 mois je n’ai pu écrire qu’une seule fois à ma famille ! C’est en arrivant à Harzungen, une carte où nous avions le droit d’écrire 5 mots et en allemand. En réalité, ils voulaient donner notre adresse à nos familles pour recevoir des colis. Quand je suis rentré, j’ai su que ma femme, mes parents, mes frères, avaient envoyé environ 40 colis. Je n’en ai reçu aucun. Dans mon kommando de 3 X 8 personne n’en a reçu. Quelques-uns ont été appelés pour recevoir un colis ; ils revenaient avec le papier d’emballage sans rien dedans. Mon ami Vincent qui coiffait les tziganes chefs de block et autres qui gardaient les cheveux longs m’a raconté qu’il avait été invité par ces messieurs à un banquet où il y avait foie gras et champagne à volonté. On croyait que c’était les SS qui piquaient les colis alors que c’était les tziganes, tout puissants à Harzungen.
______________________
(58) « tititah » est la représentation Morse de la lettre U
Additif écrit en 1996
Depuis mon récit il y a quelques années, je dois reconnaître que quelques erreurs se sont glissées.
J'ai dit que je n'avais jamais entendu parler de Marcel Paul avant mon arrivée à Buchenwald, alors que je l'ai rencontré maintes fois à Compiègne où il était toujours avec les communistes de Clermont-Ferrand devenus mes amis.
Ailleurs j'ai écrit, que chaque équipe des 3 X 8 aux tunnels de Woffleben étaient à un moment 1 500, j'ai commis une erreur. Tout au début, quand nous avons commencé à creuser les 28 tunnels de Woffleben nous étions 350 par équipe. Au camp d'Harzungen nous dormions un seul par étage du lit. Quand les tunnels sont arrivés à hauteur des premières salles les reliant entre eux, ils ont doublé les équipes, une qui continuait droit et une autre qui creusait le premier rang des salles. Quand l'équipe du tunnel est arrivée à hauteur du 2ème rang, le premier rang n'en était qu'à moitié, ces salles étaient beaucoup plus grandes que le tunnel. Ils ont rajouté une autre équipe. Nous dormions à 3 par étage, le 3ème grattant avec ses pieds le nez des autres. J’ai dit que l'effectif avait doublé, alors qu'il n'avait augmenté que de 50%, ce qui aurait dû faire 1 050, au lieu de 1 500. En réalité, comme il y avait des morts, des pendus et des disparus, le total de chaque équipe n'a pas dû atteindre le chiffre de 1 000.
Quand nous avons bifurqué sur Ellrich, il y avait déjà beaucoup de morts, notre équipe était je crois d'environ 700.
Quand le 5 avril nous sommes montés dans le célèbre train qui a divagué pendant cinq jours pour arriver à Bergen-Belsen, notre équipe a tenu dans un seul wagon. Nous étions serrés, mais moins que dans le train de Compiègne à Buchenwald. Je pense que nous étions environ 90, mais plus que 40 environ, à l'arrivée à Bergen-Belsen, et j’étais le seul français au milieu de russes et de polonais.
Quand les américains sont arrivés à Ellrich, ils ont trouvé la comptabilité intacte (ailleurs ils avaient tout brûlé). Toutes les arrivées depuis le début étaient soigneusement inscrites, et même par nationalité. Les sorties (toutes pour le crématoire) étaient indiquées au jour le jour. Ces documents ont été présentés au procès de Nuremberg, et ils doivent être dans les archives. Il ressortait de ces chiffres qu'il y avait eu à Ellrich un rescapé sur 17. Mais ces chiffres ne vont que de la création du camp au 5 avril. Dans le train qui nous a amenés à Bergen, il y a encore eu 50% de morts, ce qui ramène le nombre de rescapés à 1 sur 34. J'ai lu quelque part que le vrai chiffre était de 1 sur 37.
Or il y a eu pire dans un autre kommando de Dora. Pas bien loin d'Ellrich, il y avait un autre Kommando dont je n'avais jamais entendu parler. Quand nous sommes retournés sur les lieux, nous l'avons visité. C'était sans doute la première usine souterraine de Dora car c'était une succession de grottes naturelles où ils montaient des moteurs d'avion. Personne ne peut dire combien ils étaient, ni combien sont morts dans ces grottes, mais le 5 avril, ils ont évacué, comme nous, mais ils ne sont pas montés dans un train, ils sont partis à pied. Dans leur état, et sans rien manger, ils n'ont pas dû faire beaucoup de kilomètres. Le 13 avril ils sont arrivés dans un village qui s'appelle Gardelegen. On leur a dit d’entrer dans une grande grange qui contenait encore du foin. Pendant qu'ils se couchaient dans ce foin, les SS ont solidement barricadé les issues, et ils ont mis le feu. Il parait que le maire de ce village avait offert sa grange aux SS « Pour éliminer cette vermine ». Il n'y a eu aucun rescapé. Les habitants du village ont dû dégager les cadavres pour les faire disparaître et ils les ont comptés : un peu plus de 1 000.
Combien de déportés sont passés par ce kommando de Dora ? On ne le saura jamais. J'ai passé toute ma déportation à 10 km de là et je n'avais jamais entendu parler de lui.
Depuis quelques années, les média français voudraient nous faire croire que les juifs étaient déportés dans des camps d'extermination, alors que les résistants et les otages allaient dans des camps de concentration, où ils attendaient paisiblement la fin de la guerre. Ce ne sont pas les survivants juifs qui racontent ça, car s’ils ont survécu, c’est parce qu'ils ont survécu dans un camp de résistants, après l'évacuation, le 18 janvier (je crois) du camp d'Auschwitz. Ils ont été répartis dans d'autres camps dont Dora où j'en ai connu quelques-uns qui y sont morts. Hélas, ils ne risquent pas de témoigner, puisqu'ils y sont morts. Mais il y a de faux déportés juifs, qui n'ont eu aucune difficulté à survivre puisqu'ils n'ont jamais été déportés. Je connais aussi des non-juifs.
Je citerais d'abord un non-juif, un médecin. Quand je suis arrivé à Nice en 1953, il était président de la section de la FNDIR-ADIF (59) des Alpes-Maritimes à laquelle j'ai adhéré. Il avait son cabinet sur la Promenade des Anglais (pas une petite rue de Nice). Vers 1960 nous nous sommes aperçus qu'en réalité c'était un collabo qui avait suivi l'ennemi, mais qu'il était revenu comme soi-disant déporté. Dès que l'information a circulé, il est parti aux Amériques. Beaucoup plus tard, il y a seulement 4 à 5 ans, c'est un juif. Il était chez nous depuis les années 60. A l'époque il y avait pas mal de juifs à notre association, on se rencontrait souvent et nous étions tous copains. Une seule chose m'avait un peu surpris c'est sa jeunesse. Il était nettement plus jeune que moi, et à Auschwitz il aurait dû logiquement passer à la chambre à gaz. Mais je n'ai pas cherché à comprendre. Il y a 4 à 5 ans, le journal « Le Déporté » a publié un long article (sur 2 ou 3 numéros) signé de ce juif. Il racontait la vie à Auschwitz où il était au kommando qui faisait fonctionner la chambre à gaz. Son récit était poignant bien sûr, mais j'ai vu tellement pire que cela ne m’a ni surpris ni paru suspect. Quelques mois après, le journal a publié un communiqué fort embarrassé disant : « Nous nous excusons, le récit que nous avons publié, signé de M. Y de Nice est un faux ». Nous avons reçu des protestations de plusieurs organisations juives. Non seulement ce récit est loin de la vérité, mais c'est une copie mot à mot d’un récit d'un polonais dont on sait depuis bien longtemps qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce camp. Notre juif de Nice n'a plus reparu à notre association. Ce sont les juifs eux-mêmes qui ont découvert cet imposteur.
Ce que racontent les médias est stupide, les vrais déportés juifs savent bien qu'il y avait des camps plus terribles qu'Auschwitz. Mais parmi les résistants ou otages il n'y avait que des gens en état de travailler, et il n'y avait pas besoin de chambre à gaz pour supprimer ceux qui n'étaient pas aptes au travail. Ceux qui étaient aptes ne risquaient pas de passer à la chambre à gaz. Les nazis avaient bien trop besoin de travailleurs, juifs ou pas. Nous étions tous condamnés à mort, mais, après avoir travaillé comme esclaves, pour effectuer les travaux les plus dangereux, les plus durs, sans nourriture ou presque, et gratis. Les vrais déportés juifs sont navrés de ce que racontent les média. De plus ils voient bien que cela apporte de l'eau au moulin des négationnistes ou révisionnistes. Ce qui s'est passé est assez horrible sans en rajouter en multipliant les chiffres.
A quand une loi pour mettre en prison les reporters qui présentent ce qu'ils imaginent comme des vérités dont les jeunes devront se souvenir ? J'en ai même entendu un dire avec une émotion feinte : « Et ces 6 millions de juifs qui sont morts dans les chambres à gaz de Buchenwald, Dachau, etc. ». II a cité une dizaine de camps de déportés résistants où il n'y a jamais eu de chambre à gaz, il n'a pas cité Auschwitz où justement elles étaient.
Quand les reporters se renseigneront un peu avant de dire des sottises, les choses iront moins mal. Ce sont eux qui déforment l'information et provoquent la haine raciale. Et surtout anti-française. Jusqu'au Président Chirac qui déclare solennellement que la France et les Français sont responsables de la déportation des juifs… alors que pendant plus de 30 ans les organisations juives ont reconnu que 90 % des juifs français avaient échappé aux arrestations grâce aux résistants mais aussi à tous les Français dont de nombreux curés et bonnes sœurs qui les ont nourris et cachés. Le Président de tous les Français devrait mieux se renseigner avant de parler, puisqu'il était trop jeune à cette époque. Ce n'est pas De Gaulle qui aurait dit ça ! Je lui ai écrit aussitôt, mais j'attends toujours sa réponse.
Nos députés ont été assez stupides pour voter une loi qui interdit de rétablir la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité, ce qui a eu pour effet de laisser croire aux jeunes que ce sont les révisionnistes ou autres négationnistes qui ont raison. Tous les déportés savent qu'il y avait des chambres à gaz à Auschwitz, mais si on continue de leur dire que seuls les Juifs ont souffert de la déportation, certains pourraient en venir à aider les négationnistes.
____________________
(59) Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance – Association des Déportés, Internés et Familles des Disparus
Rendons à César
J'avais écrit les pages précédentes, en partie pour les éditeurs de deux revues apicoles qui voulaient faire connaitre une partie de ma vie plutôt agitée (c'est fait) et aussi à la demande de neveux et petits neveux, qui s'intéressent à ce que j'ai fait.
Je reprends ma machine à écrire, nous sommes début 92 ! Certains qu'on appelle « révisionnistes » que j'appellerais plutôt déviationnistes contestent ce qui s'est passé dans les camps de déportés. J'adresse donc ces témoignages à mon amicale de déportés, peut-être un jour quelqu'un s'y intéressera-t-il ?
Pour faire bien, il eut fallu taper ce texte un peu mieux, et sous une forme différente, mais je suis vieux, et je l’envoie comme il est. Par contre, je peux ajouter quelques précisions, fournir des détails complémentaires et donner mon opinion personnelle, sur les événements en question. Je ne puis témoigner sur les chambres à gaz puisque dans les camps où je suis passé il n’y en avait pas. Tout ce que je peux affirmer à ce sujet, c'est que j'ai connu des déportés passés au camp d’Auschwitz qui ont atterri dans le camp où j'étais, et tous nous parlaient des chambres à gaz, tout en reconnaissant par ailleurs que le camp d’Auschwitz était un « paradis » à côté d'Ellrich ou Dora.
Je ne peux pas croire que certains puissent contester l'existence des fours crématoires, puisqu'il y en avait dans tous les camps un tant soit peu importants.
J'ai dit par ailleurs qu’à Ellrich j'étais souvent de corvée, au retour du tunnel, pour porter des morts jusqu'au crématoire. Je peux préciser que les porteurs ne rentraient pas dans la salle des fours, mais de l'extérieur on voyait bien deux portes. Il y en avait d'autres, mais je ne peux dire combien. Un kapo nous obligeait à jeter le corps du mort aussi haut que possible, sur le tas, qui de chaque côté de la porte s'agrandissait tous les jours. En mars 45, je peux affirmer de la façon la plus formelle que les fours crématoires d'Ellrich n'arrivaient pas brûler tous les cadavres ; les deux tas grossissaient un peu plus chaque jour.
Plus d'une fois je me suis dit : « A quand mon tour ? ». Et maintenant j'essaie de faire le point. Lorsque à Buchenwald Marcel Paul m'a sorti du kommando peinard qui partait pour Schönebeck, pour me mettre le lendemain dans celui qui partait pour Dora, c'était sans doute pour m'éviter de longues souffrances (à Dora on mourait plus vite). Ce kommando était d'environ 1 500, en majorité des russes et des polonais, seulement une centaine de français et autant de belges. Parmi ces 100 français, surtout des gars de Saint-Claude. Pour moi, le contact avec le commandant Cogny et tous les officiers de l'ORA qui étaient avec moi jusque-là, était rompu et cela m'ennuyait beaucoup. Ils ont été envoyés à Dora, eux aussi, mais un autre jour, et je ne les ai jamais revus.
Sur la centaine de français de ce convoi, je n’en connaissais que deux, ils avaient fait avec moi le trajet Moulins-Compiègne, et à partir de là, bien entendu, nous sommes devenus très intimes. C'était Vincent Buiguez et Albert Bigot. A Harzungen, Vincent a eu la chance de rentrer au kommando des « friseurs ». Il n'allait plus travailler au tunnel, mais il ne nous a jamais oubliés. Bigot et moi partagions la demi-gamelle de soupe qu'il se débrouillait à nous apporter de temps en temps. Sans l’aide de Vincent, je serais probablement mort à Ellrich. Fin janvier Bigot était très mal en point ! En revenant du travail, je l'ai porté presque tout le temps (6 km, mais il ne pesait pas lourd), je l'ai porté jusqu'au revier et il a été admis.
Le lendemain je crois, en sortant du travail, la colonne a tourné vers Ellrich au lieu de tourner vers Harzungen. Je ne peux pas dire combien il restait de français vivants à cette date parmi les 100 partis ensemble de Buchenwald. Je pense environ 80. Jusque-là, il n'y avait pas énormément de morts. Arrivés à Ellrich, les Français (les autres aussi d'ailleurs) tout le kommando fondait comme neige au soleil. Le 31 mars j'étais le seul français au milieu des russes. Cela ne me rassurait guère. Heureusement pour moi, ils étaient à bout eux aussi, et ils m'ont laissé tranquille. II y avait quand même trois belges, mais ils sont morts tous les trois pendant le voyage d’Ellrich à Bergen-Belsen. Au débarquement à la gare de Bergen, nous avions reformé un petit groupe de français. Sur les cent partis avec moi de Buchenwald en juin 44, et passés à Ellrich, je suis le seul rescapé !